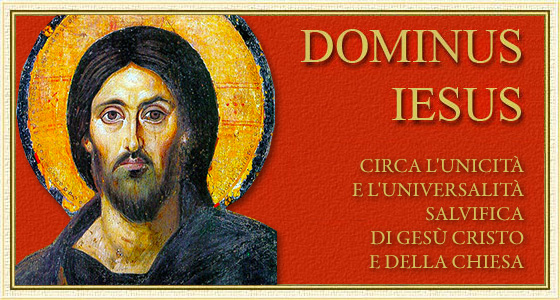À SES FRÈRES DANS L'ÉPISCOPAT
AU CLERGÉ
AUX FAMILLES RELIGIEUSES
AUX FIDÈLES
DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE
ET À TOUS LES HOMMES
DE BONNE VOLONTÉ
À L'OCCASION DU CENTENAIRE
DE L'ENCYCLIQUE
RERUM NOVARUM
Frères vénérés,
chers Fils et Filles,
salut et Bénédiction apostolique !
INTRODUCTION
1. Le centenaire de la promulgation de l'encyclique de mon prédécesseur Léon XIII, de vénérée mémoire, qui commence par les mots Rerum novarum (1) marque une date de grande importance dans la présente période de l'histoire de l'Eglise et aussi dans mon pontificat. En effet, cette encyclique a eu le privilège d'être commémorée, de son quarantième à son quatre-vingt-dixième anniversaire, par des documents solennels des Souverains Pontifes : on peut dire que le destin historique de Rerum novarum a été rythmé par d'autres documents qui attiraient l'attention sur elle et en même temps l'actualisaient (2).
En faisant de même pour le centième anniversaire, à la demande de nombreux évêques, d'institutions ecclésiales, de centres universitaires, de dirigeants d'entreprises et de travailleurs, à titre individuel ou comme membres d'associations, je voudrais avant tout honorer la dette de gratitude qu'a toute l'Eglise à l'égard du grand Pape et de son « document immortel » (3). Je voudrais aussi montrer que la sève généreuse qui monte de cette racine n'a pas été épuisée au fil des ans, mais qu'au contraire elle est devenue plus féconde. En témoignent les initiatives de natures diverses qui ont précédé, qui accompagnent et qui suivront cette célébration, initiatives prises par les Conférences épiscopales, par des Organisations internationales, des Universités et des institutions académiques, des associations professionnelles et d'autres institutions ou personnes dans de nombreuses régions du monde.
2. La présente encyclique prend place dans ces célébrations, pour rendre grâce à Dieu de qui vient « tout don excellent, et toute donation parfaite » (Jc 1, 17 ), parce qu'il s'est servi d'un document venant du Siège de Pierre il y a cent ans pour faire beaucoup de bien et répandre beaucoup de lumière dans l'Eglise et dans le monde. La commémoration que l'on fait ici concerne l'encyclique de Léon XIII, et en même temps les encycliques et les autres documents de mes prédécesseurs qui ont contribué à attirer l'attention sur elle et à développer son influence au long des années en constituant ce qu'on allait appeler la « doctrine sociale », « l'enseignement social » ou encore le « magistère social » de l'Eglise.
Deux encycliques que j'ai publiées au cours de mon pontificat se réfèrent déjà à cet enseignement qui garde sa valeur : Laborem exercens sur le travail humain, et Sollicitudo rei socialis sur les problèmes actuels du développement des hommes et des peuples.
3. Je voudrais proposer maintenant une « relecture » de l'encyclique de Léon XIII, et inviter à porter un regard « rétrospectif » sur son texte lui-même afin de redécouvrir la richesse des principes fondamentaux qui y sont formulés pour la solution de la question ouvrière. Mais j'invite aussi à porter un regard « actuel » sur les « choses nouvelles » qui nous entourent et dans lesquelles nous nous trouvons immergés, pour ainsi dire, bien différentes des « choses nouvelles » qui caractérisaient l'ultime décennie du siècle dernier. J'invite enfin à porter le regard « vers l'avenir », alors qu'on entrevoit déjà le troisième millénaire de l'ère chrétienne, lourd d'inconnu mais aussi de promesses. Inconnu et promesses qui font appel à notre imagination et à notre créativité, qui nous stimulent aussi, en tant que disciples du Christ, le « Maître unique » (cf. Mt 23, 8), dans notre responsabilité de montrer la voie, de proclamer la vérité et de communiquer la vie qu'il est lui-même (cf. Jn 14, 6).
En agissant ainsi, non seulement on réaffirmera la valeur permanente de cet enseignement, mais on manifestera aussi le vrai sens de la Tradition de l'Eglise qui, toujours vivante et active, construit sur les fondations posées par nos pères dans la foi et particulièrement sur ce que « les Apôtres ont transmis à l'Eglise » (5) au nom de Jésus-Christ : il est le fondement et « nul n'en peut poser d'autre » (cf. 1 Co 3, 11).
C'est en vertu de la conscience qu'il avait de sa mission de successeur de Pierre que Léon XIII décida de prendre la parole, et c'est la même conscience qui anime aujourd'hui son successeur. Comme lui, et comme les Papes avant et après lui, je m'inspire de l'image évangélique du « scribe devenu disciple du Royaume des cieux », dont le Seigneur dit qu'il « est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien » (Mt 13, 52). Le trésor est le grand courant de la Tradition de l'Eglise qui contient les « choses anciennes », reçues et transmises depuis toujours, et qui permet de lire les « choses nouvelles » au milieu desquelles se déroule la vie de l'Eglise et du monde.
De ces choses qui, en s'incorporant à la Tradition, deviennent anciennes et qui offrent les matériaux et l'occasion de son enrichissement comme de l'enrichissement de la vie de la foi, fait partie aussi l'activité féconde de millions et de millions d'hommes qui, stimulés par l'enseignement social de l'Eglise, se sont efforcés de s'en inspirer pour leur engagement dans le monde. Agissant individuellement ou rassemblés de diverses manières en groupes, associations et organisations, ils ont constitué comme un grand mouvement pour la défense de la personne humaine et la protection de sa dignité, ce qui a contribué, à travers les vicissitudes diverses de l'histoire, à construire une société plus juste ou du moins à freiner et à limiter l'injustice.
La présente encyclique cherche à mettre en lumière la fécondité des principes exprimés par Léon XIII, principes qui appartiennent au patrimoine doctrinal de l'Eglise et, à ce titre, engagent l'autorité de son magistère. Mais la sollicitude pastorale m'a conduit, d'autre part, à proposer l'analyse de certains événements récents de l'histoire. Il n'est pas besoin de souligner que la considération attentive du cours des événements, en vue de discerner les exigences nouvelles de l'évangélisation, relève des devoirs qui incombent aux Pasteurs. Toutefois, on n'entend pas exprimer des jugements définitifs en développant ces considérations, car, en elles-mêmes, elles n'entrent pas dans le cadre propre du magistère.
I. TRAITS CARACTÉRISTIQUES DE "RERUM NOVARUM"
4. Vers la fin du siècle dernier, l'Eglise dut faire face à un processus historique qui avait déjà commencé depuis quelque temps mais atteignait alors un point critique. Parmi les facteurs déterminants de ce processus, il y eut un ensemble de changements radicaux qui se produisirent dans le domaine politique, économique et social mais aussi dans le cadre de la science et de la technique, sans oublier les influences multiples des idéologies dominantes. Dans le domaine politique, ces changements engendrèrent une nouvelle conception de la société et de l'Etatet, par conséquent, de l'autorité. Une société traditionnelle disparaissait tandis qu'une autre commençait à voir le jour, marquée par l'espoir de nouvelles libertés, mais également par le risque de nouvelles formes d'injustice et d'esclavage.
Dans le domaine économique, où convergeaient les découvertes et les applications des sciences, on avait progressivement atteint de nouvelles structures pour la production des biens de consommation. On avait assisté à l'apparition d'une nouvelle forme de propriété, le capital, et d'une nouvelle forme de travail, le travail salarié, caractérisé par de pénibles rythmes de production, négligeant toute considération de sexe, d'âge ou de situation familiale, uniquement déterminé par l'efficacité en vue d'augmenter le profit.
Ainsi, le travail devenait une marchandise qui pouvait être librement acquise et vendue sur le marché et dont le prix n'était établi qu'en fonction de la loi de l'offre et de la demande, sans tenir compte du minimum vital nécessaire à la subsistance de la personne et de sa famille. De plus, le travailleur n'était pas même certain de réussir à vendre sa « marchandise » et il se trouvait constamment sous la menace du chômage, ce qui, en l'absence de protection sociale, lui faisait courir le risque de mourir de faim.
La conséquence de cette transformation était « la division de la société en deux classes séparées par un profond abîme » (6). Cette situation s'ajoutait aux transformations d'ordre politique déjà soulignées. Ainsi, la théorie politique dominante de l'époque tendait à promouvoir la liberté économique totale par des lois adaptées ou au contraire par une absence voulue de toute intervention. Simultanément, commençait à se manifester, sous une forme organisée et d'une manière souvent violente, une autre conception de la propriété et de la vie économique qui entraînait une nouvelle structure politique et sociale.
Au paroxysme de cette opposition, alors qu'apparaissaient en pleine lumière la très grave injustice de la réalité sociale telle qu'elle existait en plusieurs endroits, et le risque d'une révolution favorisée par les idées que l'on appelait alors « socialistes », Léon XIII intervint en publiant un document qui traitait de manière systématique la « question ouvrière ». Cette encyclique avait été précédée par d'autres, consacrées davantage à des enseignements de caractère politique, tandis que d'autres encore devaient suivre (7). C'est dans ce contexte qu'il convient d'évoquer en particulier l'encyclique Libertas praestantissimumdans laquelle était rappelé le lien constitutif de la liberté humaine avec la vérité, lien si fort qu'une liberté qui refuserait de se lier à la vérité tomberait dans l'arbitraire et finirait par se soumettre elle-même aux passions les plus dégradantes et par s'autodétruire. D'où viennent, en effet, tous les maux que veut combattre Rerum novarum sinon d'une liberté qui, dans le domaine de l'activité économique et sociale, s'éloigne de la vérité de l'homme ?
D'autre part, le Souverain Pontife s'inspirait de l'enseignement de ses prédécesseurs ainsi que de nombreux documents épiscopaux, des études scientifiques dues à des laïcs, de l'action de mouvements et d'associations catholiques et des réalisations concrètes dans le domaine social qui marquèrent la vie de l'Eglise dans la seconde moitié du XIXème siècle.
5. Les « choses nouvelles » examinées par le Pape étaient rien moins que positives. Le premier paragraphe de l'encyclique décrit en termes vigoureux les « choses nouvelles » dont elle tire son nom : « A l'heure où grandissait le désir de choses nouvellesqui, depuis longtemps, agite les Etats, il fallait s'attendre à voir la soif de changements passer du domaine de la politique dans la sphère voisine de l'économie. En effet, l'industrie s'est développée et ses méthodes se sont complètement renouvelées. Les rapports entre patrons et ouvriers se sont modifiés, la richesse a afflué entre les mains d'un petit nombre et la multitude est dans l'indigence. Les ouvriers ont conçu une opinion plus haute d'eux-mêmes et ont contracté entre eux une union plus étroite. Tout cela, sans parler de la corruption des moeurs, a eu pour résultat de faire éclater un conflit » (8).
Le Pape et l'Eglise, ainsi que la communauté civile, se trouvaient face à une société divisée par un conflit d'autant plus dur et inhumain qu'il ne connaissait ni règle ni norme, le conflit entre capital et travail ou, comme le dit l'encyclique, la question ouvrière. Précisément sur ce conflit, dans les conditions critiques que l'on observait alors, le Pape n'hésita pas à donner son jugement.
Ici intervient la première réflexion suggérée par l'encyclique pour notre temps. Face à un conflit qui opposait les hommes entre eux, pour ainsi dire comme des « loups », jusque sur le plan de la subsistance matérielle des uns et de l'opulence des autres, le Pape ne craignait pas d'intervenir en vertu de sa « charge apostolique » (9), c'est-à-dire de la mission qu'il a reçue de Jésus-Christ lui-même de « paître les agneaux et les brebis » (cf. Jn 21, 15-17), de « lier et délier sur la terre » pour le Royaume des cieux (cf. Mt 16, 19). Son intention était certainement de rétablir la paix, et le lecteur d'aujourd'hui ne peut que remarquer la sévère condamnation de la lutte des classes qu'il prononça sans appel (10). Mais il était bien conscient du fait que la paix s'édifie sur le fondement de la justice : l'encyclique avait précisément pour contenu essentiel de proclamer les conditions fondamentales de la justice dans la conjoncture économique et sociale de l'époque.
Léon XIII, à la suite de ses prédécesseurs, établissait de la sorte un modèle permanent pour l'Eglise. Celle-ci, en effet, a une parole à dire face à des situations humaines déterminées, individuelles et communautaires, nationales et internationales, pour lesquelles elle énonce une véritable doctrine, un corpus qui lui permet d'analyser les réalités sociales, comme aussi de se prononcer sur elles et de donner des orientations pour la juste solution des problèmes qu'elles posent.
Du temps de Léon XIII, une telle conception des droits et des devoirs de l'Eglise était bien loin d'être communément admise. En effet, deux tendances prédominaient : l'une, tournée vers ce monde et vers cette vie, à laquelle la foi devait rester étrangère ; l'autre, vers un salut purement situé dans l'au-delà, et qui n'apportait ni lumière ni orientations pour la vie sur terre. En publiant Rerum novarum, le Pape donnait pour ainsi dire « droit de cité » à l'Eglise dans les réalités changeantes de la vie publique. Cela devait se préciser davantage encore par la suite. En effet, l'enseignement et la diffusion de la doctrine sociale de l'Eglise appartiennent à sa mission d'évangélisation ; c'est une partie essentielle du message chrétien, car cette doctrine en propose les conséquences directes dans la vie de la société et elle place le travail quotidien et la lutte pour la justice dans le cadre du témoignage rendu au Christ Sauveur. Elle est également une source d'unité et de paix face aux conflits qui surgissent inévitablement dans le domaine économique et social. Ainsi, il devient possible de vivre les nouvelles situations sans amoindrir la dignité transcendante de la personne humaine ni en soi-même ni chez les adversaires, et de trouver la voie de solutions correctes.
A cent ans de distance, la valeur d'une telle orientation m'offre l'occasion d'apporter une contribution à l'élaboration de la « doctrine sociale chrétienne ». La « nouvelle évangélisation », dont le monde moderne a un urgent besoin et sur laquelle j'ai insisté de nombreuses fois, doit compter parmi ses éléments essentiels l'annonce de la doctrine sociale de l'Eglise, apte, aujourd'hui comme sous Léon XIII, à indiquer le bon chemin pour répondre aux grands défis du temps présent, dans un contexte de discrédit croissant des idéologies. Comme à cette époque, il faut répéter qu'il n'existe pas de véritable solution de la « question sociale » hors de l'Evangile et que, d'autre part, les « choses nouvelles » peuvent trouver en lui leur espace de vérité et la qualification morale qui convient.
6. En se proposant de faire la lumière sur le conflit survenu entre le capital et le travail, Léon XIII affirmait les droits fondamentaux des travailleurs. C'est pourquoi la clé de lecture du texte pontifical est la dignité du travailleur en tant que tel et, de ce fait, la dignité du travail défini comme « l'activité humaine ordonnée à la satisfaction des besoins de la vie, notamment à sa conservation » (12). Le Pape qualifiait le travail de « personnel », parce que « la force de travail est inhérente à la personne et appartient en propre à celui qui l'exerce et dont elle est l'apanage » (13). Le travail appartient ainsi à la vocation de toute personne ; l'homme s'exprime donc et se réalise dans son activité laborieuse. Le travail possède en même temps une dimension « sociale », par sa relation étroite tant avec la famille qu'avec le bien commun, « puisqu'on peut affirmer sans se tromper que le travail des ouvriers est à l'origine de la richesse des Etats » (14). Tels sont les points que j'ai repris et développés dans l'encyclique Laborem exercens (15).
Il existe sans aucun doute un autre principe important, celui du droit à la « propriété privée ». La longueur du développement que lui consacre l'encyclique révèle à elle seule l'importance qui lui revient. Le Pape est bien conscient du fait que la propriété privée n'est pas une valeur absolue et il ne manque pas de proclamer les principes complémentaires indispensables, tels que celui de la destination universelle des biens de la terre (17).
Par ailleurs, s'il est vrai que le type de propriété privée qu'il considère au premier chef est celui de la propriété de la terre (18), il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui conservent leur valeur les raisons avancées pour protéger la propriété privée, c'est-à-dire pour affirmer le droit de posséder ce qui est nécessaire au développement personnel et à celui de sa famille, quelle que soit la forme effective prise par ce droit. Il faut l'affirmer une nouvelle fois devant les changements, dont nous sommes les témoins, survenus dans les systèmes où régnait le principe de la propriété collective des moyens de production, mais également devant les situations toujours plus nombreuses de pauvreté ou, plus exactement, devant les négations de la propriété privée, qui se présentent dans beaucoup de régions du monde, y compris celles où prédominent les systèmes qui reposent sur l'affirmation du droit à la propriété privée. A la suite de ces changements et de la persistance de la pauvreté, une analyse plus profonde du problème s'avère nécessaire, ce qui sera fait plus loin.
7. En relation étroite avec le droit de propriété, l'encyclique de Léon XIII affirme également d'autres droits, en disant qu'ils sont inhérents à la personne humaine et inaliénables. Au rang de ces droits, le « droit naturel de l'homme » à former des associations privées occupe une place de premier plan par l'ampleur du développement que lui consacre le Pape et l'importance qu'il lui attribue ; il s'agit avant tout du droit à créer des associations professionnelles de chefs d'entreprise et d'ouvriers ou simplement d'ouvriers (19). On saisit ici le motif pour lequel l'Eglise défend et approuve la création de ce qu'on appelle couramment des syndicats, non certes par préjugé idéologique ni pour céder à une mentalité de classe, mais parce que s'associer est un droit naturel de l'être humain et, par conséquent, un droit antérieur à sa reconnaissance par la société politique. En effet, « il n'est pas au pouvoir de l'Etat d'interdire leur existence », car « l'Etat est fait pour protéger et non pour détruire le droit naturel. En interdisant de telles associations, il s'attaquerait lui-même » (20).
Avec ce droit que le Pape — il est juste de le souligner — reconnaît explicitement aux ouvriers, ou, pour reprendre ses termes, aux « prolétaires », sont affirmés de manière tout aussi claire les droits à la « limitation des heures de travail », au repos légitime et à une différence de traitement pour les enfants et les femmes (21) en ce qui concerne la forme et la durée du travail.
Si l'on se souvient de ce que nous apprend l'histoire au sujet des pratiques admises, ou du moins pas interdites par la loi, dans le domaine des contrats, qui étaient passés sans aucune garantie d'horaires ni de conditions d'hygiène dans le travail, sans respect non plus pour l'âge ou le sexe des candidats à l'emploi, on comprend bien la sévérité des paroles du Pape. « Il n'est ni juste ni humain, écrivait-il, d'exiger de l'homme un travail tel qu'il s'abrutisse l'esprit et s'affaiblisse le corps par suite d'une fatigue excessive ». Et, de manière plus précise, en se référant au contrat, qui a pour objectif de faire entrer en vigueur de telles « relations de travail », il affirme : « Dans toute convention passée entre patrons et ouvriers, figure la condition expresse ou tacite » que l'on ménagera un temps de repos convenable, en proportion des « forces dépensées dans le travail » ; puis il conclut : « Un pacte contraire serait immoral » (22).
8. Immédiatement après, le Pape énonce un autre droit du travailleur en tant que personne. Il s'agit du droit à un « juste salaire », droit qui ne peut être laissé « au libre consentement des parties, de telle sorte que l'employeur, après avoir payé le salaire convenu, aurait rempli ses engagements et ne semblerait rien devoir d'autre » (23). L'Etat — disait-on à cette époque — n'a pas le pouvoir d'intervenir dans la détermination de ces contrats, sinon pour veiller à l'accomplissement de ce qui a été expressément convenu. Une telle conception des rapports entre patrons et ouvriers, purement pragmatique et inspirée par un individualisme strict, est sévèrement critiquée dans l'encyclique comme contraire à la double nature du travail en tant que fait personnel et nécessaire. En effet, si le travail, en tant que personnel, fait partie des capacités et des forces dont chacun a la libre disposition, il est, en tant que nécessaire, régi par le grave devoir pour chacun de « se garder en vie » ; « de ce devoir, conclut le Pape, découle nécessairement le droit de se procurer ce qui sert à la subsistance, que les pauvres ne se procurent que moyennant le salaire de leur travail » (24).
Le salaire doit suffire à faire vivre l'ouvrier et sa famille. Si le travailleur, « contraint par la nécessité ou poussé par la crainte d'un mal plus grand, accepte des conditions très dures, que d'ailleurs il ne peut refuser parce qu'elles lui sont imposées par le patron ou par celui qui fait l'offre du travail, il subit une violence contre laquelle la justice proteste » (25).
Dieu veuille que ces phrases, écrites tandis que progressait ce qu'on a appelé le « capitalisme sauvage », ne soient pas à reprendre et à répéter aujourd'hui avec la même sévérité ! Malheureusement, aujourd'hui encore, on trouve des cas de contrats passés entre patrons et ouvriers qui ignorent la justice la plus élémentaire en matière de travail des mineurs ou des femmes, pour les horaires de travail, les conditions d'hygiène dans les locaux et la juste rétribution. Cela arrive malgré lesDéclarations et les Conventions internationales qui en traitent (26), et même les lois des divers Etats. Le Pape assignait à l'« autorité publique » le « strict devoir » de prendre grand soin du bien-être des travailleurs, parce qu'en ne le faisant pas, on offensait la justice, et il n'hésitait pas à parler de « justice distributive » (27).
9. A ces droits, Léon XIII en ajoute un autre, toujours à propos de la condition ouvrière, que je désire rappeler, étant donné son importance : le droit d'accomplir librement ses devoirs religieux. Le Pape le proclame clairement dans le contexte des autres droits et devoirs des ouvriers, malgré le climat général où, déjà de son temps, on considérait que certaines questions appartenaient exclusivement au domaine de la vie privée. Il affirme la nécessité du repos dominical, afin de rappeler à l'homme la pensée des biens célestes et du culte que l'on doit à la majesté divine (28). De ce droit, qui s'enracine dans un commandement fondamental, personne ne peut priver l'homme : « Il n'est permis à personne de violer impunément cette dignité de l'homme que Dieu lui-même traite avec un grand respect ». Par conséquent, l'Etat doit assurer à l'ouvrier l'exercice de cette liberté (29).
On ne se tromperait pas en voyant en germe, dans cette affirmation claire, le principe du droit à la liberté religieuse, qui est devenu depuis lors l'objet de nombreuses Déclarationset Conventions internationales solennelles (30), sans oublier la célèbre Déclaration conciliaire et mes enseignements fréquents (31). Sur ce point, nous devons nous demander si les dispositions légales en vigueur et les pratiques des sociétés industrialisées permettent aujourd'hui d'assurer effectivement l'exercice de ce droit élémentaire au repos dominical.
10. Une autre donnée importante, riche d'enseignements pour notre époque, est la conception des rapports de l'Etat avec les citoyens. Rerum novarum critique les deux systèmes sociaux et économiques, le socialisme et le libéralisme. Elle consacre au premier la partie initiale qui réaffirme le droit à la propriété privée. Au contraire, il n'y a pas de section spécialement consacrée au second système, mais — et ceci mérite que l'on y porte attention — les critiques à son égard apparaissent lorsqu'est traité le thème des devoirs de l'Etat (32). L'Etat ne peut se borner à « veiller sur une partie de ses citoyens », celle qui est riche et prospère, et il ne peut « négliger l'autre », qui représente sans aucun doute la grande majorité du corps social. Sinon il est porté atteinte à la justice qui veut que l'on rende à chacun ce qui lui appartient. « Toutefois, dans la protection des droits privés, il doit se préoccuper d'une manière spéciale des petits et des pauvres. La classe riche, qui est forte de par ses biens, a moins besoin de la protection publique ; la classe pauvre, sans richesse pour la mettre à l'abri, compte surtout sur la protection de l'Etat. L'Etat doit donc entourer de soins et d'une sollicitude toute particulière les travailleurs qui appartiennent à la foule des déshérités » (33).
Ces passages gardent leur valeur aujourd'hui, surtout face aux nouvelles formes de pauvreté qui existent dans le monde, d'autant que des affirmations si importantes ne dépendent nullement d'une conception déterminée de l'Etat ni d'une théorie politique particulière. Le Pape reprend un principe élémentaire de toute saine organisation politique : dans une société, plus les individus sont vulnérables, plus ils ont besoin de l'intérêt et de l'attention que leur portent les autres, et, en particulier, de l'intervention des pouvoirs publics.
Ainsi, le principe de solidarité, comme on dit aujourd'hui, dont j'ai rappelé, dans l'encyclique Sollicitudo rei socialis (34), la valeur dans l'ordre interne de chaque nation comme dans l'ordre international, apparaît comme l'un des principes fondamentaux de la conception chrétienne de l'organisation politique et sociale. Il a été énoncé à plusieurs reprises par Léon XIII sous le nom d'« amitié » que nous trouvons déjà dans la philosophie grecque. Pie XI le désigna par le terme non moins significatif de « charité sociale », tandis que Paul VI, élargissant le concept en fonction des multiples dimensions modernes de la question sociale, parlait de « civilisation de l'amour » (35).
11. En relisant l'encyclique à la lumière de la situation contemporaine, on peut se rendre compte de la sollicitude et de l'action incessantes de l'Eglise en faveur des catégories de personnes qui sont objet de prédilection de la part du Seigneur Jésus. Le contenu du texte est un excellent témoignage de la continuité, dans l'Eglise, de ce qu'on appelle l'« option préférentielle pour les pauvres », option définie comme une « forme spéciale de priorité dans la pratique de la charité chrétienne » (36). L'encyclique sur la « question ouvrière » est donc une encyclique sur les pauvres et sur la terrible condition à laquelle le processus d'industrialisation nouveau et souvent violent avait réduit de très nombreuses personnes. Aujourd'hui encore, dans une grande partie du monde, de tels processus de transformation économique, sociale et politique produisent les mêmes fléaux.
Si Léon XIII en appelle à l'Etat pour remédier selon la justice à la condition des pauvres, il le fait aussi parce qu'il reconnaît, à juste titre, que l'Etat a le devoir de veiller au bien commun et de pourvoir à ce que chaque secteur de la vie sociale, sans exclure celui de l'économie, contribue à le promouvoir, tout en respectant la juste autonomie de chacun d'entre eux. Toutefois, il ne faudrait pas en conclure que, pour le Pape Léon XIII, la solution de la question sociale devrait dans tous les cas venir de l'Etat. Au contraire, il insiste à plusieurs reprises sur les nécessaires limites de l'intervention de l'Etat et sur sa nature de simple instrument, puisque l'individu, la famille et la société lui sont antérieurs et que l'Etat existe pour protéger leurs droits respectifs sans jamais les opprimer (37).
L'actualité de ces réflexions n'échappe à personne. Il conviendra de reprendre plus loin ce thème important des limites inhérentes à la nature de l'Etat. Les points soulignés, qui ne sont pas les seuls abordés par l'encyclique, se situent dans la continuité de l'enseignement social de l'Eglise, et sont éclairés par une saine conception de la propriété privée, du travail, du développement économique, de la nature de l'Etat et, avant tout, de l'homme lui-même. D'autres thèmes seront mentionnés par la suite quand on examinera certains aspects de la réalité contemporaine, mais dès maintenant, il convient de garder présent à l'esprit que ce qui sert de trame et, d'une certaine manière, de guide à l'encyclique et à toute la doctrine sociale de l'Eglise, c'est la juste conception de la personne humaine, de sa valeur unique, dans la mesure où « l'homme est sur la terre la seule créature que Dieu ait voulue pour elle-même » (38). Dans l'homme, il a sculpté son image, à sa ressemblance (cf. Gn 1, 26), en lui donnant une dignité incomparable, sur laquelle l'encyclique insiste à plusieurs reprises. En effet, au-delà des droits que l'homme acquiert par son travail, il existe des droits qui ne sont corrélatifs à aucune de ses activités mais dérivent de sa dignité essentielle de personne.
II. VERS LES "CHOSES NOUVELLES" D'AUJOURD'HUI
12. L'anniversaire de Rerum novarum ne serait pas célébré comme il convient si l'on ne regardait pas également la situation actuelle. Déjà, par son contenu, l'encyclique se prête à une telle réflexion ; en effet, le cadre historique et les prévisions qui y sont tracées se révèlent d'une exactitude surprenante, à la lumière de tous les événements ultérieurs.
Les faits des derniers mois de l'année 1989 et du début de 1990 en ont été une confirmation singulière. Ils ne s'expliquent, de même que les transformations radicales qui s'en sont suivies, qu'en fonction des situations antérieures qui avaient cristallisé ou institutionnalisé, dans une certaine mesure, les prévisions de Léon XIII et les signes toujours plus inquiétants perçus par ses successeurs. En effet, le Pape Léon XIII prévoyait les conséquences négatives — sous tous les aspects : politique, social et économique — d'une organisation de la société telle que la proposait le « socialisme », qui en était alors au stade d'une philosophie sociale et d'un mouvement plus ou moins structuré. On pourrait s'étonner de ce que le Pape parte du « socialisme » pour faire la critique des solutions qu'on donnait de la « question ouvrière », alors que le socialisme ne se présentait pas encore, comme cela se produisit ensuite, sous la forme d'un Etat fort et puissant, avec toutes les ressources à sa disposition. Toutefois, il mesura bien le danger que représentait pour les masses la présentation séduisante d'une solution aussi simple que radicale de la « question ouvrière » d'alors. Cela est plus vrai encore si l'on considère l'effroyable condition d'injustice à laquelle étaient réduites les masses prolétariennes dans les nations récemment industrialisées.
Il faut ici souligner deux choses: d'une part, la grande lucidité avec laquelle est perçue, dans toute sa rigueur, la condition réelle des prolétaires, hommes, femmes et enfants; d'autre part, la clarté non moins grande avec laquelle est saisi ce qu'il y a de mauvais dans une solution qui, sous l'apparence d'un renversement des situations des pauvres et des riches, portait en réalité préjudice à ceux-là mêmes qu'on se promettait d'aider. Le remède se serait ainsi révélé pire que le mal. En caractérisant la nature du socialisme de son époque, qui supprimait la propriété privée, Léon XIII allait au coeur du problème.
Ses paroles méritent d'être relues avec attention: « Les socialistes, pour guérir ce mal [l'injuste distribution des richesses et la misère des prolétaires], poussent les pauvres à être jaloux de ceux qui possèdent. Ils prétendent que toute propriété de biens privés doit être supprimée, que les biens de chacun doivent être communs à tous... Mais pareille théorie, loin d'être capable de mettre fin au conflit, ferait tort à l'ouvrier si elle était appliquée. D'ailleurs, elle est souverainement injuste, parce qu'elle fait violence aux propriétaires légitimes, dénature les fonctions de l'Etat et bouleverse de fond en comble l'édifice social » (39). On ne saurait pas mieux indiquer les maux entraînés par l'instauration de ce type de socialisme comme système d'Etat, qui prendrait le nom de « socialisme réel ».
13. Approfondissant maintenant la réflexion et aussi en référence à tout ce qui a été dit dans les encycliques Laborem exercens et Sollicitudo rei socialis, il faut ajouter que l'erreur fondamentale du « socialisme » est de caractère anthropologique. En effet, il considère l'individu comme un simple élément, une molécule de l'organisme social, de sorte que le bien de chacun est tout entier subordonné au fonctionnement du mécanisme économique et social, tandis que, par ailleurs, il estime que ce même bien de l'individu peut être atteint hors de tout choix autonome de sa part, hors de sa seule et exclusive décision responsable devant le bien ou le mal. L'homme est ainsi réduit à un ensemble de relations sociales, et c'est alors que disparaît le concept de personne comme sujet autonome de décision morale qui construit l'ordre social par cette décision. De cette conception erronée de la personne découlent la déformation du droit qui définit la sphère d'exercice de la liberté, ainsi que le refus de la propriété privée. En effet, l'homme dépossédé de ce qu'il pourrait dire « sien » et de la possibilité de gagner sa vie par ses initiatives en vient à dépendre de la machine sociale et de ceux qui la contrôlent ; cela lui rend beaucoup plus difficile la reconnaissance de sa propre dignité de personne et entrave la progression vers la constitution d'une authentique communauté humaine.
Au contraire, de la conception chrétienne de la personne résulte nécessairement une vision juste de la société. SelonRerum novarum et toute la doctrine sociale de l'Eglise, le caractère social de l'homme ne s'épuise pas dans l'Etat, mais il se réalise dans divers groupes intermédiaires, de la famille aux groupes économiques, sociaux, politiques et culturels qui, découlant de la même nature humaine, ont — toujours à l'intérieur du bien commun — leur autonomie propre. C'est ce que j'ai appelé la « personnalité » de la société qui, avec la personnalité de l'individu, a été éliminée par le « socialisme réel » (40).
Si on se demande ensuite d'où naît cette conception erronée de la nature de la personne humaine et de la personnalité de la société, il faut répondre que la première cause en est l'athéisme. C'est par sa réponse à l'appel de Dieu contenu dans l'être des choses que l'homme prend conscience de sa dignité transcendante. Tout homme doit donner cette réponse, car en elle il atteint le sommet de son humanité, et aucun mécanisme social ou sujet collectif ne peut se substituer à lui. La négation de Dieu prive la personne de ses racines et, en conséquence, incite à réorganiser l'ordre social sans tenir compte de la dignité et de la responsabilité de la personne.
L'athéisme dont on parle est, du reste, étroitement lié au rationalisme de la philosophie des lumières, qui conçoit la réalité humaine et sociale d'une manière mécaniste. On nie ainsi l'intuition ultime de la vraie grandeur de l'homme, sa transcendance par rapport au monde des choses, la contradiction qu'il ressent dans son coeur entre le désir d'une plénitude de bien et son impuissance à l'obtenir et, surtout, le besoin de salut qui en dérive.
14. C'est de cette même racine de l'athéisme que découle le choix des moyens d'action propre au socialisme condamné dansRerum novarum. Il s'agit de la lutte des classes. Le Pape, bien entendu, n'entend pas condamner tout conflit social sous quelque forme que ce soit : l'Eglise sait bien que les conflits d'intérêts entre divers groupes sociaux surgissent inévitablement dans l'histoire et que le chrétien doit souvent prendre position à leur sujet avec décision et cohérence. L'encyclique Laborem exercens, du reste, a reconnu clairement le rôle positif du conflit quand il prend l'aspect d'une « lutte pour la justice sociale » (41) ; et déjà dans Quadragesimo anno on lit : « La lutte des classes, en effet, quand on s'abstient d'actes de violence et de haine réciproque, se transforme peu à peu en une honnête discussion, fondée sur la recherche de la justice » (42).
Ce qui est condamné dans la lutte des classes, c'est plutôt l'idée d'un conflit dans lequel n'interviennent pas de considérations de caractère éthique ou juridique, qui se refuse à respecter la dignité de la personne chez autrui (et, par voie de conséquence, en soi- même), qui exclut pour cela un accommodement raisonnable et recherche non pas le bien général de la société, mais plutôt un intérêt de parti qui se substitue au bien commun et veut détruire ce qui s'oppose à lui. Il s'agit, en un mot, de la reprise — dans le domaine du conflit interne entre groupes sociaux — de la doctrine de la « guerre totale » que le militarisme et l'impérialisme de l'époque faisaient prévaloir dans le domaine des rapports internationaux. Cette doctrine substituait à la recherche du juste équilibre entre les intérêts des diverses nations celle de la prédominance absolue de son propre parti moyennant la destruction de la capacité de résistance du parti adverse, effectuée par tous les moyens, y compris le mensonge, la terreur à l'encontre des populations civiles et les armes d'extermination (qui étaient en élaboration précisément durant ces années-là). La lutte des classes au sens marxiste et le militarisme ont donc la même racine : l'athéisme, et le mépris de la personne humaine qui fait prévaloir le principe de la force sur celui de la raison et du droit.
15. Rerum novarum s'oppose — comme on l'a dit — à l'étatisation des instruments de production, qui réduirait chaque citoyen à n'être qu'une pièce dans la machine de l'Etat. Elle critique aussi résolument la conception de l'Etat qui laisse le domaine de l'économie totalement en dehors de son champ d'intérêt et d'action. Certes, il existe une sphère légitime d'autonomie pour les activités économiques, dans laquelle l'Etat ne doit pas entrer. Cependant, il a le devoir de déterminer le cadre juridique à l'intérieur duquel se déploient les rapports économiques et de sauvegarder ainsi les conditions premières d'une économie libre, qui présuppose une certaine égalité entre les parties, d'une manière telle que l'une d'elles ne soit pas par rapport à l'autre puissante au point de la réduire pratiquement en esclavage (43).
A ce sujet, Rerum novarum montre la voie des justes réformes susceptibles de redonner au travail sa dignité d'activité libre de l'homme. Ces réformes supposent que la société et l'Etat prennent leurs responsabilités surtout pour défendre le travailleur contre le cauchemar du chômage. Cela s'est réalisé historiquement de deux manières convergentes : soit par des politiques économiques destinées à assurer une croissance équilibrée et une situation de plein emploi ; soit par les assurances contre le chômage et par des politiques de recyclage professionnel appropriées pour faciliter le passage des travailleurs de secteurs en crise vers d'autres secteurs en développement.
En outre, la société et l'Etat doivent assurer des niveaux de salaire proportionnés à la subsistance du travailleur et de sa famille, ainsi qu'une certaine possibilité d'épargne. Cela requiert des efforts pour donner aux travailleurs des connaissances et des aptitudes toujours meilleures et susceptibles de rendre leur travail plus qualifié et plus productif ; mais cela requiert aussi une surveillance assidue et des mesures législatives appropriées pour couper court aux honteux phénomènes d'exploitation, surtout au détriment des travailleurs les plus démunis, des immigrés ou des marginaux. Dans ce domaine, le rôle des syndicats, qui négocient le salaire minimum et les conditions de travail, est déterminant.
Enfin, il faut garantir le respect d'horaires « humains » pour le travail et le repos, ainsi que le droit d'exprimer sa personnalité sur les lieux de travail, sans être violenté en aucune manière dans sa conscience ou dans sa dignité. Là encore, il convient de rappeler le rôle des syndicats, non seulement comme instruments de négociation mais encore comme « lieux » d'expression de la personnalité : ils sont utiles au développement d'une authentique culture du travail et ils aident les travailleurs à participer d'une façon pleinement humaine à la vie de l'entreprise (44).
L'Etat doit contribuer à la réalisation de ces objectifs directement et indirectement. Indirectement et suivant le principe de subsidiarité, en créant les conditions favorables au libre exercice de l'activité économique, qui conduit à une offre abondante de possibilités de travail et de sources de richesse. Directement et suivant le principe de solidarité, en imposant, pour la défense des plus faibles, certaines limites à l'autonomie des parties qui décident des conditions du travail, et en assurant dans chaque cas un minimum vital au travailleur sans emploi (45).
L'encyclique et l'enseignement social qui la prolonge ont influencé de multiples manières les dernières années du XIXème siècle et le début du XXème. Cette influence est à l'origine de nombreuses réformes introduites dans les secteurs de la prévoyance sociale, des retraites, des assurances contre les maladies, de la prévention des accidents, tout cela dans le cadre d'un respect plus grand des droits des travailleurs (46).
16. Les réformes furent en partie réalisées par les Etats, mais, dans la lutte pour les obtenir, l'action du Mouvement ouvrier a joué un rôle important. Né d'une réaction de la conscience morale contre des situations injustes et préjudiciables, il déploya une vaste activité syndicale et réformiste, qui était loin des brumes de l'idéologie et plus proche des besoins quotidiens des travailleurs et, dans ce domaine, ses efforts se joignirent souvent à ceux des chrétiens pour obtenir l'amélioration des conditions de vie des travailleurs.
Par la suite, ce mouvement fut dans une certaine mesure dominé précisément par l'idéologie marxiste contre laquelle se dressaitRerum novarum.
Ces mêmes réformes furent aussi le résultat d'un libre processus d'auto-organisation de la société, avec la mise au point d'instruments efficaces de solidarité, aptes à soutenir une croissance économique plus respectueuse des valeurs de la personne. Il faut rappeler ici les multiples activités, avec la contribution notable des chrétiens, d'où ont résulté la fondation de coopératives de production, de consommation et de crédit, la promotion de l'instruction populaire et de la formation professionnelle, l'expérimentation de diverses formes de participation à la vie de l'entreprise et, en général, de la société.
Si donc, en regardant le passé, il y a des raisons de remercier Dieu parce que la grande encyclique n'est pas restée sans résonance dans les coeurs et a poussé à une générosité active, néanmoins il faut reconnaître que l'annonce prophétique dont elle était porteuse n'a pas été complètement accueillie par les hommes de l'époque, et qu'à cause de cela de très grandes catastrophes se sont produites.
17. Quand on lit l'encyclique en la reliant à tout le riche enseignement du Pape Léon XIII (47), on voit qu'au fond elle montre les conséquences d'une erreur de très grande portée sur le terrain économique et social. L'erreur, comme on l'a dit, consiste en une conception de la liberté humaine qui la soustrait à l'obéissance à la vérité et donc aussi au devoir de respecter les droits des autres hommes. Le sens de la liberté se trouve alors dans un amour de soi qui va jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, dans un amour qui conduit à l'affirmation illimitée de l'intérêt particulier et ne se laisse arrêter par aucune obligation de justice (48).
Les conséquences extrêmes de cette erreur sont apparues dans le cycle tragique des guerres qui ont secoué l'Europe et le monde entre 1914 et 1945. Il s'agit de guerres provoquées par un militarisme et un nationalisme exacerbés et par les formes de totalitarisme qui y sont liées, il s'agit de guerres provoquées par la lutte des classes, de guerres civiles et idéologiques. Sans le poids implacable de haine et de rancune, accumulées à la suite de tant d'injustices au niveau international et au niveau interne des Etats, on n'aurait pu connaître des guerres d'une telle férocité, où de grandes nations engagèrent leurs forces vives, où l'on n'hésita pas devant la violation des droits les plus sacrés de l'homme et où fut planifiée et exécutée l'extermination de peuples et de groupes sociaux entiers. Nous nous souvenons ici en particulier du peuple juif dont le terrible destin est devenu un symbole de l'aberration à laquelle l'homme peut arriver quand il se tourne contre Dieu.
Toutefois, la haine et l'injustice ne s'emparent de nations entières et ne les poussent à l'action que lorsqu'elles sont légitimées et organisées par des idéologies qui se fondent plus sur elles que sur la vérité de l'homme (49). Rerum novarum combattait les idéologies de la haine et a montré les manières de mettre un terme à la violence et à la rancœur par la justice. Puisse le souvenir de ces terribles événements guider les actions de tous les hommes et, en particulier, des gouvernants des peuples de notre temps, alors que d'autres injustices alimentent de nouvelles haines et que se profilent à l'horizon de nouvelles idéologies qui exaltent la violence !
18. Certes, depuis 1945 les armes se taisent sur le continent européen ; toutefois, on se rappellera que la vraie paix n'est jamais le résultat de la victoire militaire, mais suppose l'élimination des causes de la guerre et l'authentique réconciliation entre les peuples. Pendant de nombreuses années, par contre, il y a eu en Europe et dans le monde une situation de non- guerre plus que de paix authentique. La moitié du continent est tombée sous le pouvoir de la dictature communiste, tandis que l'autre partie s'organisait pour se défendre contre ce type de danger. Bien des peuples perdent le pouvoir de disposer d'eux-mêmes, sont enfermés dans les limites d'un empire oppressif tandis qu'on s'efforce de détruire leur mémoire historique et les racines séculaires de leur culture. Des masses énormes d'hommes, à la suite de cette violente partition, sont contraintes d'abandonner leur terre et déportées de force.
Une course folle aux armements absorbe les ressources nécessaires au développement des économies internes et à l'aide aux nations les plus défavorisées. Le progrès scientifique et technique, qui devrait contribuer au bien-être de l'homme, est transformé en instrument de guerre. La science et la technique servent à produire des armes toujours plus perfectionnées et plus destructrices, tandis qu'on demande à une idéologie, qui est une perversion de la philosophie authentique, de fournir des justifications doctrinales à la nouvelle guerre. Et la guerre est non seulement attendue et préparée, mais elle a lieu dans diverses régions du monde et cause d'énormes effusions de sang. De la logique des blocs, ou des empires, dénoncée par les documents de l'Eglise et récemment par l'encyclique Sollicitudo rei socialis (50), il résulte que les controverses et les discordes qui naissent dans les pays du Tiers-Monde sont systématiquement amplifiées et exploitées pour créer des difficultés à l'adversaire.
Les groupes extrémistes, qui cherchent à résoudre ces controverses par les armes, bénéficient facilement d'appuis politiques et militaires, sont armés et entraînés à la guerre, tandis que ceux qui s'efforcent de trouver des solutions pacifiques et humaines, respectant les intérêts légitimes de toutes les parties, restent isolés et sont souvent victimes de leurs adversaires. La militarisation de nombreux pays du Tiers-Monde et les luttes fratricides qui les ont tourmentés, la diffusion du terrorisme et de procédés toujours plus barbares de lutte politico-militaire trouvent aussi une de leurs principales causes dans la précarité de la paix qui a suivi la deuxième guerre mondiale. Sur le monde entier, enfin, pèse la menace d'une guerre atomique, capable de conduire à l'extinction de l'humanité. La science, utilisée à des fins militaires, met à la disposition de la haine, amplifiée par les idéologies, l'arme absolue. Mais la guerre peut se terminer sans vainqueurs ni vaincus dans un suicide de l'humanité, et alors il faut répudier la logique qui y conduit, c'est-à-dire l'idée que la lutte pour la destruction de l'adversaire, la contradiction et la guerre même sont des facteurs de progrès et de marche en avant de l'histoire (51). Si on admet la nécessité de ce refus, la logique de la « guerre totale » comme celle de la « lutte des classes » sont nécessairement remises en cause.
19. Mais à la fin de la deuxième guerre mondiale, un tel processus est encore en train de prendre forme dans les esprits, et le fait qui retient l'attention est l'extension du totalitarisme communiste sur plus de la moitié de l'Europe et sur une partie du monde. La guerre, qui aurait dû rétablir la liberté et restaurer le droit des gens, se conclut sans avoir atteint ces buts, mais au contraire d'une manière qui les contredit ouvertement pour beaucoup de peuples, spécialement ceux qui avaient le plus souffert. On peut dire que la situation qui s'est créée a provoqué des réactions différentes.
Dans quelques pays et à certains points de vue, on assiste à un effort positif pour reconstruire, après les destructions de la guerre, une société démocratique inspirée par la justice sociale, qui prive le communisme du potentiel révolutionnaire représenté par les masses humaines exploitées et opprimées. Ces tentatives cherchent en général à maintenir les mécanismes du marché libre, en assurant par la stabilité de la monnaie et la sécurité des rapports sociaux les conditions d'une croissance économique stable et saine, avec laquelle les hommes pourront par leur travail construire un avenir meilleur pour eux et pour leurs enfants. En même temps, on cherche à éviter que les mécanismes du marché soient l'unique point de référence de la vie sociale et on veut les assujettir à un contrôle public qui s'inspire du principe de la destination commune des biens de la terre. Une certaine abondance des offres d'emploi, un système solide de sécurité sociale et de préparation professionnelle, la liberté d'association et l'action vigoureuse des syndicats, la protection sociale en cas de chômage, les instruments de participation démocratique à la vie sociale, tout cela, dans un tel contexte, devrait soustraire le travail à la condition de « marchandise » et garantir la possibilité de l'accomplir dignement.
En second lieu, d'autres forces sociales et d'autres écoles de pensée s'opposent au marxisme par la construction de systèmes de « sécurité nationale » qui visent à contrôler d'une façon capillaire toute la société pour rendre impossible l'infiltration marxiste. En exaltant et en augmentant le pouvoir de l'Etat, ces systèmes entendent préserver leurs peuples du communisme ; mais, ce faisant, ils courent le risque grave de détruire la liberté et les valeurs de la personne au nom desquelles il faut s'y opposer.
Enfin, une autre forme pratique de réponse est représentée par la société du bien-être, ou société de consommation. Celle-ci tend à l'emporter sur le marxisme sur le terrain du pur matérialisme, montrant qu'une société de libre marché peut obtenir une satisfaction des besoins matériels de l'homme plus complète que celle qu'assure le communisme, tout en excluant également les valeurs spirituelles. En réalité, s'il est vrai, d'une part, que ce modèle social montre l'incapacité du marxisme à construire une société nouvelle et meilleure, d'un autre côté, en refusant à la morale, au droit, à la culture et à la religion leur réalité propre et leur valeur, il le rejoint en réduisant totalement l'homme à la sphère économique et à la satisfaction des besoins matériels.
20. Dans la même période se déroule un impressionnant processus de « décolonisation », dans lequel de nombreux pays acquièrent ou reconquièrent leur indépendance et le droit à disposer librement d'eux-mêmes. Cependant, avec la reconquête formelle de leur souveraineté d'Etat, ces pays se trouvent souvent juste au début du chemin dans la construction d'une authentique indépendance. En fait, des secteurs décisifs de l'économie demeurent encore entre les mains de grandes entreprises étrangères, qui n'acceptent pas de se lier durablement au développement du pays qui leur donne l'hospitalité, et la vie politique elle-même est contrôlée par des forces étrangères, tandis qu'à l'intérieur des frontières de l'Etat cohabitent des groupes ethniques, non encore complètement intégrés dans une authentique communauté nationale. En outre, il manque un groupe de fonctionnaires compétents, capables d'administrer d'une façon honnête et juste l'appareil de l'Etat, ainsi que des cadres pour une gestion efficace et responsable de l'économie.
Etant donné cette situation, il semble à beaucoup que le marxisme peut offrir comme un raccourci pour l'édification de la nation et de l'Etat, et c'est pour cette raison que voient le jour diverses variantes du socialisme avec un caractère national spécifique. Elles se mêlent ainsi aux nombreuses idéologies qui se constituent différemment suivant les cas : exigences légitimes de salut national, formes de nationalisme et aussi de militarisme, principes tirés d'antiques sagesses populaires, parfois accordés avec la doctrine sociale chrétienne, et les concepts du marxisme-léni- nisme.
21. Il faut rappeler enfin qu'après la deuxième guerre mondiale et aussi en réaction contre ses horreurs, s'est répandu un sentiment plus vif des droits de l'homme, qui a trouvé une reconnaissance dans divers Documents internationaux (52) et, pourrait-on dire, dans l'élaboration d'un nouveau « droit des gens » à laquelle le Saint-Siège a apporté constamment sa contribution. Le pivot de cette évolution a été l'Organisation des Nations unies. Non seulement la conscience du droit des individus s'est développée, mais aussi celle des droits des nations, tandis qu'on saisit mieux la nécessité d'agir pour porter remède aux graves déséquilibres entre les différentes aires géographiques du monde, qui, en un sens, ont déplacé le centre de la question sociale du cadre national au niveau international (53).
En prenant acte de cette évolution avec satisfaction, on ne peut cependant passer sous silence le fait que le bilan d'ensemble des diverses politiques d'aide au développement n'est pas toujours positif. Aux Nations unies, en outre, on n'a pas réussi jusqu'à maintenant à élaborer des procédés efficaces, autres que la guerre, pour la solution des conflits internationaux, et cela semble être le problème le plus urgent que la communauté internationale ait encore à résoudre.
III. L'ANNÉE 1989
22. C'est à partir de la situation mondiale qui vient d'être décrite, et qui a déjà été largement exposée dans l'encycliqueSollicitudo rei socialis, que l'on comprend la portée inattendue et prometteuse des événements de ces dernières années. Leur point culminant, sans aucun doute, ce sont les événements survenus en 1989 dans les pays de l'Europe centrale et orientale, mais ils couvrent une période et un espace géographique plus larges. Au cours des années 1980, on voit s'écrouler progressivement dans plusieurs pays d'Amérique latine, et aussi d'Afrique et d'Asie, certains régimes de dictature et d'oppression. Dans d'autres cas commence un cheminement, difficile mais fécond, de transition vers des formes politiques qui laissent plus de place à la participation et à la justice. L'Eglise a fourni une contribution importante, et même décisive, par son engagement en faveur de la défense et de la promotion des droits de l'homme : dans des milieux fortement imprégnés d'idéologie, où les prises de position radicales obscurcissaient le sens commun de la dignité humaine, l'Eglise a affirmé avec simplicité et énergie que tout homme, quelles que soient ses convictions personnelles, porte en lui l'image de Dieu et mérite donc le respect. La grande majorité du peuple s'est bien souvent reconnue dans cette affirmation, et cela a conduit à rechercher des formes de lutte et des solutions politiques plus respectueuses de la dignité de la personne.
De ce processus historique sont sorties de nouvelles formes de démocratie qui suscitent l'espoir d'un changement dans les structures politiques et sociales précaires, grevées de l'hypothèque d'une douloureuse série d'injustices et de rancœurs, qui s'ajoutent à une économie désastreuse et à de pénibles conflits sociaux. Tout en rendant grâce à Dieu, en union avec toute l'Eglise, pour le témoignage, parfois héroïque, que beaucoup de Pasteurs, de communautés chrétiennes comme de simples fidèles et d'autres hommes de bonne volonté ont donné en ces circonstances difficiles, je le prie de soutenir les efforts accomplis par tous pour bâtir un avenir meilleur. C'est là, en effet, une responsabilité qui incombe non seulement aux citoyens de ces pays mais à tous les chrétiens et aux hommes de bonne volonté. Il s'agit de montrer que les problèmes complexes de ces peuples peuvent être résolus par la méthode du dialogue et de la solidarité, et non par la lutte pour détruire l'adversaire ou par la guerre.
23. Parmi les nombreux facteurs de la chute des régimes oppressifs, certains méritent d'être rappelés d'une façon particulière. Le facteur décisif qui a mis en route les changements est assurément la violation des droits du travail. On ne saurait oublier que la crise fondamentale des systèmes qui se prétendent l'expression du gouvernement et même de la dictature des ouvriers commence par les grands mouvements survenus en Pologne au nom de la solidarité. Les foules ouvrières elles-mêmes ôtent sa légitimité à l'idéologie qui prétend parler en leur nom, et elles retrouvent, elles redécouvrent presque, à partir de l'expérience vécue et difficile du travail et de l'oppression, des expressions et des principes de la doctrine sociale de l'Eglise.
Un autre fait mérite d'être souligné : à peu près partout, on est arrivé à faire tomber un tel « bloc », un tel empire, par une lutte pacifique, qui a utilisé les seules armes de la vérité et de la justice. Alors que, selon le marxisme, ce n'est qu'en poussant à l'extrême les contradictions sociales que l'on pouvait les résoudre dans un affrontement violent, les luttes qui ont amené l'écroulement du marxisme persistent avec ténacité à essayer toutes les voies de la négociation, du dialogue, du témoignage de la vérité, faisant appel à la conscience de l'adversaire et cherchant à réveiller en lui le sens commun de la dignité humaine.
Apparemment, l'ordre européen issu de la deuxième guerre mondiale et consacré par les Accords de Yaltane pouvait être ébranlé que par une autre guerre. Et pourtant, il s'est trouvé dépassé par l'action non violente d'hommes qui, alors qu'ils avaient toujours refusé de céder au pouvoir de la force, ont su trouver dans chaque cas la manière efficace de rendre témoignage à la vérité. Cela a désarmé l'adversaire, car la violence a toujours besoin de se légitimer par le mensonge, de se donner l'air, même si c'est faux, de défendre un droit ou de répondre à une menace d'autrui (54). Encore une fois, nous rendons grâce à Dieu qui a soutenu le cœur des hommes au temps de la difficile épreuve, et nous prions pour qu'un tel exemple serve en d'autres lieux et en d'autres circonstances. Puissent les hommes apprendre à lutter sans violence pour la justice, en renonçant à la lutte des classes dans les controverses internes et à la guerre dans les controverses internationales !
24. Comme deuxième facteur de crise, il y a bien certainement l'inefficacité du système économique, qu'il ne faut pas considérer seulement comme un problème technique mais plutôt comme une conséquence de la violation des droits humains à l'initiative, à la propriété et à la liberté dans le domaine économique. Il convient d'ajouter à cet aspect la dimension culturelle et nationale : il n'est pas possible de comprendre l'homme en partant exclusivement du domaine de l'économie, il n'est pas possible de le définir en se fondant uniquement sur son appartenance à une classe. On comprend l'homme d'une manière plus complète si on le replace dans son milieu culturel, en considérant sa langue, son histoire, les positions qu'il adopte devant les événements fondamentaux de l'existence comme la naissance, l'amour, le travail, la mort. Au centre de toute culture se trouve l'attitude que l'homme prend devant le mystère le plus grand, le mystère de Dieu. Au fond, les cultures des diverses nations sont autant de manières d'aborder la question du sens de l'existence personnelle : quand on élimine cette question, la culture et la vie morale des nations se désagrègent. C'est pourquoi la lutte pour la défense du travail s'est liée spontanément à la lutte pour la culture et pour les droits nationaux.
Mais la cause véritable de ces nouveautés est le vide spirituel provoqué par l'athéisme qui a laissé les jeunes générations démunies d'orientations et les a amenées bien souvent, dans la recherche irrésistible de leur identité et du sens de la vie, à redécouvrir les racines religieuses de la culture de leurs nations et la personne même du Christ, comme réponse existentiellement adaptée à la soif de vérité et de vie qui est au cœur de tout homme. Cette recherche a été encouragée par le témoignage de ceux qui, dans des circonstances difficiles et au milieu des persécutions, sont restés fidèles à Dieu. Le marxisme s'était promis d'extirper du cœur de l'homme la soif de Dieu, mais les résultats ont montré qu'il est impossible de le faire sans bouleverser le cœur de l'homme.
25. Les événements de 1989 donnent l'exemple du succès remporté par la volonté de négocier et par l'esprit évangélique face à un adversaire décidé à ne pas se laisser arrêter par des principes moraux ; ils constituent donc un avertissement pour tous ceux qui, au nom du réalisme politique, veulent bannir de la politique le droit et la morale. Certes, la lutte qui a conduit aux changements de 1989 a exigé de la lucidité, de la modération, des souffrances et des sacrifices ; en un sens, elle est née de la prière et elle aurait été impensable sans une confiance illimitée en Dieu, Seigneur de l'histoire, qui tient en main le coeur de l'homme. C'est en unissant sa souffrance pour la vérité et la liberté à celle du Christ en Croix que l'homme peut accomplir le miracle de la paix et est capable de découvrir le sentier souvent étroit entre la lâcheté qui cède au mal et la violence qui, croyant le combattre, l'aggrave.
On ne peut cependant ignorer les innombrables conditionnements au milieu desquels la liberté de l'individu est amenée à agir ; ils affectent, certes, la liberté, mais ils ne la déterminent pas ; ils rendent son exercice plus ou moins facile, mais ils ne peuvent la détruire. Non seulement on n'a pas le droit de méconnaître, du point de vue éthique, la nature de l'homme qui est fait pour la liberté, mais en pratique ce n'est même pas possible. Là où la société s'organise en réduisant arbitrairement ou même en supprimant le champ dans lequel s'exerce légitimement la liberté, il en résulte que la vie sociale se désagrège progressivement et entre en décadence.
En outre, l'homme, créé pour la liberté, porte en lui la blessure du péché originel qui l'attire continuellement vers le mal et fait qu'il a besoin de rédemption. Non seulement cette doctrine fait partie intégrante de la Révélation chrétienne, mais elle a une grande valeur herméneutique car elle aide à comprendre la réalité humaine. L'homme tend vers le bien, mais il est aussi capable de mal ; il peut transcender son intérêt immédiat et pourtant lui rester lié. L'ordre social sera d'autant plus ferme qu'il tiendra davantage compte de ce fait et qu'il n'opposera pas l'intérêt personnel à celui de la société dans son ensemble, mais qu'il cherchera plutôt comment assurer leur fructueuse coordination. En effet, là où l'intérêt individuel est supprimé par la violence, il est remplacé par un système écrasant de contrôle bureaucratique qui tarit les sources de l'initiative et de la créativité. Quand les hommes croient posséder le secret d'une organisation sociale parfaite qui rend le mal impossible, ils pensent aussi pouvoir utiliser tous les moyens, même la violence ou le mensonge, pour la réaliser. La politique devient alors une « religion séculière » qui croit bâtir le paradis en ce monde. Mais aucune société politique, qui possède sa propre autonomie et ses propres lois (55), ne pourra jamais être confondue avec le Royaume de Dieu. La parabole évangélique du bon grain et de l'ivraie (cf. Mt 13, 24-30. 36-43) enseigne qu'il appartient à Dieu seul de séparer les sujets du Royaume et les sujets du Malin, et que ce jugement arrivera à la fin des temps. En prétendant porter dès maintenant le jugement, l'homme se substitue à Dieu et s'oppose à la patience de Dieu.
Par le sacrifice du Christ sur la Croix, la victoire du Royaume de Dieu est acquise une fois pour toutes. Cependant la condition chrétienne comporte la lutte contre les tentations et les forces du mal. Ce n'est qu'à la fin de l'histoire que le Seigneur reviendra en gloire pour le jugement final (cf. Mt 25, 31) et l'instauration des cieux nouveaux et de la terre nouvelle (cf. 2 P 3, 13 ; Ap 21, 1). Mais, tant que dure le temps, le combat du bien et du mal se poursuit jusque dans le cœur de l'homme.
Ce que l'Ecriture nous apprend des destinées du Royaume de Dieu n'est pas sans conséquences pour la vie des sociétés temporelles qui, comme l'indique l'expression, appartiennent aux réalités du temps, avec ce que cela comporte d'imparfait et de provisoire. Le Royaume de Dieu, présent dans le monde sans être du monde, illumine l'ordre de la société humaine, alors que les énergies de la grâce pénètrent et vivifient cet ordre. Ainsi sont mieux perçues les exigences d'une société digne de l'homme, les déviations sont redressées, le courage d'œuvrer pour le bien est conforté. A cette tâche d'animation évangélique des réalités humaines sont appelés, avec tous les hommes de bonne volonté, les chrétiens, et tout spécialement les laïcs (56).
26. Les événements de 1989 se sont déroulés principalement dans les pays d'Europe orientale et centrale. Ils ont toutefois une portée universelle car il en est résulté des conséquences positives et négatives qui intéressent toute la famille humaine. Ces conséquences n'ont pas un caractère mécanique ou fatidique, mais sont comme des occasions offertes à la liberté humaine de collaborer avec le dessein miséricordieux de Dieu qui agit dans l'histoire.
La première conséquence a été, dans certains pays, la rencontre entre l'Eglise et le Mouvement ouvrier né d'une réaction d'ordre éthique et explicitement chrétien, contre une situation générale d'injustice. Depuis un siècle environ, ce Mouvement était en partie tombé sous l'hégémonie du marxisme, dans la conviction que les prolétaires, pour lutter efficacement contre l'oppression, devaient faire leurs les théories matérialistes et économistes.
Dans la crise du marxisme resurgissent les formes spontanées de la conscience ouvrière qui exprime une demande de justice et de reconnaissance de la dignité du travail, conformément à la doctrine sociale de l'Eglise (57). Le Mouvement ouvrier devient un mouvement plus général des travailleurs et des hommes de bonne volonté pour la libération de la personne humaine et pour l'affirmation de ses droits ; il est répandu aujourd'hui dans de nombreux pays et, loin de s'opposer à l'Eglise catholique, il se tourne vers elle avec intérêt.
La crise du marxisme n'élimine pas du monde les situations d'injustice et d'oppression, que le marxisme lui même exploitait et dont il tirait sa force. A ceux qui, aujourd'hui, sont à la recherche d'une théorie et d'une pratique nouvelles et authentiques de libération, l'Eglise offre non seulement sa doctrine sociale et, d'une façon générale, son enseignement sur la personne, rachetée par le Christ, mais aussi son engagement et sa contribution pour combattre la marginalisation et la souffrance.
Dans un passé récent, le désir sincère d'être du côté des opprimés et de ne pas se couper du cours de l'histoire a amené bien des croyants à rechercher de diverses manières un impossible compromis entre le marxisme et le christianisme. Le moment présent dépasse tout ce qu'il y avait de caduc dans ces tentatives et incite en même temps à réaffirmer le caractère positif d'une authentique théologie de la libération intégrale de l'homme (58). Considérés sous cet angle, les événements de 1989 s'avèrent importants aussi pour les pays du Tiers-Monde, qui cherchent la voie de leur développement, comme ils l'ont été pour les pays de l'Europe centrale et orientale.
27. La deuxième conséquence concerne les peuples de l'Europe. Bien des injustices, aux niveaux individuel, social, régional et national, ont été commises pendant les années de domination du communisme et même avant ; bien des haines et des rancœurs ont été accumulées. Après l'écroulement de la dictature, celles-ci risquent fort d'exploser avec violence, provoquant de graves conflits et des deuils, si viennent à manquer la tension morale et la force de rendre consciemment témoignage à la vérité qui ont animé les efforts du passé. Il faut souhaiter que la haine et la violence ne triomphent pas dans les cœurs, surtout en ceux qui luttent pour la justice, et qu'en tous grandisse l'esprit de paix et de pardon !
Mais il faut que des démarches concrètes soient effectuées afin de créer ou de consolider des structures internationales capables d'intervenir, pour l'arbitrage convenable dans les conflits qui surgissent entre les nations, de telle sorte que chacune d'entre elles puisse faire valoir ses propres droits et parvenir à un juste accord et à un compromis pacifique avec les droits des autres. Tout cela est particulièrement nécessaire pour les nations européennes, intimement unies par les liens de leur culture commune et de leur histoire millénaire. Un effort considérable doit être consenti pour la reconstruction morale et économique des pays qui ont abandonné le communisme. Pendant très longtemps, les relations économiques les plus élémentaires ont été altérées, et même des vertus fondamentales dans le secteur économique, comme l'honnêteté, la confiance méritée, l'ardeur au travail, ont été méprisées. Une patiente reconstruction matérielle et morale est nécessaire, alors que les peuples épuisés par de longues privations demandent à leurs gouvernants des résultats tangibles et immédiats pour leur bien-être, ainsi que la satisfaction de leurs légitimes aspirations.
La chute du marxisme a eu naturellement des conséquences importantes en ce qui concerne la division de la terre en mondes fermés l'un à l'autre, opposés dans une concurrence jalouse. La réalité de l'interdépendance des peuples s'en trouve plus clairement mise en lumière, et aussi le fait que le travail humain est par nature destiné à unir les peuples et non à les diviser. La paix et la prospérité, en effet, sont des biens qui appartiennent à tout le genre humain, de sorte qu'il n'est pas possible d'en jouir d'une manière honnête et durable si on les a obtenus et conservés au détriment d'autres peuples et d'autres nations, en violant leurs droits ou en les excluant des sources du bien-être.
28. Pour certains pays d'Europe, c'est, en un sens, le véritable après-guerre qui commence. La restructuration radicale des économies jusque-là collectivisées crée des problèmes et suppose des sacrifices qui peuvent être comparés à ceux que les pays de l'ouest du continent ont dû affronter pour leur reconstruction après le deuxième conflit mondial. Il est juste que, dans les difficultés actuelles, les pays anciennement communistes soient soutenus par l'effort solidaire des autres nations: ils doivent, bien évidemment, être les premiers artisans de leur développement, mais il faut leur donner une possibilité raisonnable de le mettre en œuvre, et cela ne peut se faire sans l'aide des autres pays. D'ailleurs, la situation actuelle, marquée par les difficultés et la pénurie, est la conséquence d'un processus historique dont les pays anciennement communistes ont souvent été les victimes et non les responsables ; ils se trouvent donc dans cette situation non pas en raison de choix libres ou d'erreurs commises, mais parce que de tragiques événements historiques, imposés par la force, les ont empêchés de poursuivre leur développement économique et civil.
L'aide des autres pays, d'Europe spécialement, qui ont eu part à la même histoire et en portent les responsabilités, répond à une dette de justice. Mais elle répond aussi à l'intérêt et au bien général de l'Europe, car celle-ci ne pourra pas vivre en paix si les conflits de diverse nature qui surgissent par suite du passé sont rendus plus aigus par une situation de désordre économique, d'insatisfaction spirituelle et de désespoir.
Toutefois, une telle exigence ne doit pas entraîner une diminution des efforts pour soutenir et aider les pays du Tiers-Monde, qui connaissent souvent des conditions de carence et de pauvreté beaucoup plus graves (59). Ce qui est requis, c'est un effort extraordinaire pour mobiliser les ressources, dont le monde dans son ensemble n'est pas dépourvu, vers des objectifs de croissance économique et de développement commun, en redéfinissant les priorités et les échelles des valeurs selon lesquelles sont décidés les choix économiques et politiques. D'immenses ressources peuvent être rendues disponibles par le désarmement des énormes appareils militaires édifiés pour le conflit entre l'Est et l'Ouest. Elles pourront s'avérer encore plus abondantes si l'on arrive à mettre en place des procédures fiables — autres que la guerre — pour résoudre les conflits, puis à propager le principe du contrôle et de la réduction des armements, dans les pays du Tiers-Monde aussi, en prenant les mesures nécessaires contre leur commerce (60). Mais il faudra surtout abandonner la mentalité qui considère les pauvres — personnes et peuples — presque comme un fardeau, comme d'ennuyeux importuns qui prétendent consommer ce que d'autres ont produit. Les pauvres revendiquent le droit d'avoir leur part des biens matériels et de mettre à profit leur capacité de travail afin de créer un monde plus juste et plus prospère pour tous. Le progrès des pauvres est une grande chance pour la croissance morale, culturelle et même économique de toute l'humanité.
29. Enfin, le développement ne doit pas être compris d'une manière exclusivement économique, mais dans un sens intégralement humain (61). Il ne s'agit pas seulement d'élever tous les peuples au niveau dont jouissent aujourd'hui les pays les plus riches, mais de construire, par un travail solidaire, une vie plus digne, de faire croître réellement la dignité et la créativité de chaque personne, sa capacité de répondre à sa vocation et donc à l'appel de Dieu. Au faîte du développement, il y a la mise en oeuvre du droit et du devoir de chercher Dieu, de le connaître et de vivre selon cette connaissance (62). Dans les régimes totalitaires et autoritaires, on a poussé à l'extrême le principe de la prépondérance de la force sur la raison. L'homme a été contraint d'accepter une conception de la réalité imposée par la force et non acquise par l'effort de sa raison et l'exercice de sa liberté. Il faut inverser ce principe et reconnaître intégralement les droits de la conscience humaine, celle-ci n'étant liée qu'à la vérité naturelle et à la vérité révélée. C'est dans la reconnaissance de ces droits que se trouve le fondement premier de tout ordre politique authentiquement libre (63). Il est important de réaffirmer ce principe, pour divers motifs :
a) parce que les anciennes formes de totalitarisme et d'autoritarisme ne sont pas encore complètement anéanties et qu'il existe même un risque qu'elles reprennent vigueur : cette situation appelle à un effort renouvelé de collaboration et de solidarité entre tous les pays ;
b) parce que, dans les pays développés, on fait parfois une propagande excessive pour les valeurs purement utilitaires, en stimulant les instincts et les tendances à la jouissance immédiate, ce qui rend difficiles la reconnaissance et le respect de la hiérarchie des vraies valeurs de l'existence humaine ;
c) parce que, dans certains pays, apparaissent de nouvelles formes de fondamentalisme religieux qui, de façon voilée ou même ouvertement, refusent aux citoyens qui ont une foi différente de celle de la majorité le plein exercice de leurs droits civils ou religieux, les empêchent de participer au débat culturel, restreignent le droit qu'a l'Eglise de prêcher l'Evangile et le droit qu'ont les hommes d'accueillir la parole qu'ils ont entendu prêcher et de se convertir au Christ. Aucun progrès authentique n'est possible sans respect du droit naturel élémentaire de connaître la vérité et de vivre selon la vérité. A ce droit se rattache, comme son exercice et son approfondissement, le droit de découvrir et d'accueillir librement Jésus-Christ, qui est le vrai bien de l'homme (64).
IV. LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET LA DESTINATION UNIVERSELLE DES BIENS
30. Dans l'encyclique Rerum novarum, Léon XIII affirmait avec force, contre le socialisme de son temps, le caractère naturel du droit à la propriété privée, et il s'appuyait sur divers arguments (65). Ce droit, fondamental pour l'autonomie et le développement de la personne, a toujours été défendu par l'Eglise jusqu'à nos jours. L'Eglise enseigne de même que la propriété des biens n'est pas un droit absolu mais comporte, dans sa nature même de droit humain, ses propres limites.
Tandis qu'il proclamait le droit à la propriété privée, le Pape affirmait avec la même clarté que l'« usage » des biens, laissé à la liberté, est subordonné à leur destination originelle commune de biens créés et aussi à la volonté de Jésus-Christ, exprimée dans l'Évangile. Il écrivait en effet : « Les fortunés de ce monde sont avertis [...] qu'ils doivent trembler devant les menaces inusitées que Jésus profère contre les riches ; qu'enfin il viendra un jour où ils devront rendre à Dieu, leur juge, un compte très rigoureux de l'usage qu'ils auront fait de leur fortune» ; et, citant saint Thomas d'Aquin, il ajoutait : « Mais si l'on demande en quoi il faut faire consister l'usage des biens, l'Eglise répond sans hésitation : A ce sujet, l'homme ne doit pas tenir les choses extérieures pour privées, mais pour communes », car « au-dessus des jugements de l'homme et de ses lois, il y a la loi et le jugement de Jésus-Christ » (66).
Les successeurs de Léon XIII ont repris cette double affirmation : la nécessité et donc la licéité de la propriété privée, et aussi les limites dont elle est grevée (67). Le Concile Vatican II a également proposé la doctrine traditionnelle dans des termes qui méritent d'être cités littéralement : « L'homme, dans l'usage qu'il fait de ses biens, ne doit jamais tenir les choses qu'il possède légitimement comme n'appartenant qu'à lui, mais les regarder aussi comme communes, en ce sens qu'elles puissent profiter non seulement à lui, mais aussi aux autres ». Et un peu plus loin : « La propriété privée ou un certain pouvoir sur les biens extérieurs assurent à chacun une zone indispensable d'autonomie personnelle et familiale ; il faut les regarder comme un prolongement de la liberté humaine. [...] De par sa nature même, la propriété privée a aussi un caractère social, fondé dans la loi de commune destination des biens » (68). J'ai repris la même doctrine d'abord dans le discours d'ouverture de la III Conférence de l'épiscopat latino-américain à Puebla, puis dans les encycliques Laborem exercenset, plus récemment, Sollicitudo rei socialis (69).
31. Lorsqu'on relit dans le contexte de notre temps cet enseignement sur le droit à la propriété et la destination commune des biens, on peut se poser la question de l'origine des biens qui soutiennent la vie de l'homme, qui satisfont à ses besoins et qui sont l'objet de ses droits.
La première origine de tout bien est l'acte de Dieu lui-même qui a créé la terre et l'homme, et qui a donné la terre à l'homme pour qu'il la maîtrise par son travail et jouisse de ses fruits (cf. Gn 1, 28-29). Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier personne. C'est là l'origine de la destination universelle des biens de la terre. En raison de sa fécondité même et de ses possibilités de satisfaire les besoins de l'homme, la terre est le premier don de Dieu pour la subsistance humaine. Or, elle ne produit pas ses fruits sans une réponse spécifique de l'homme au don de Dieu, c'est-à-dire sans le travail. Grâce à son travail, l'homme, utilisant son intelligence et sa liberté, parvient à la dominer et il en fait la demeure qui lui convient. Il s'approprie ainsi une partie de la terre, celle qu'il s'est acquise par son travail. C'est là l'origine de la propriété individuelle. Evidemment, il a aussi la responsabilité de ne pas empêcher que d'autres hommes disposent de leur part du don de Dieu ; au contraire, il doit collaborer avec eux pour dominer ensemble toute la terre.
Dans l'histoire, ces deux facteurs, le travail et la terre, se retrouvent toujours au principe de toute société humaine ; cependant ils ne se situent pas toujours dans le même rapport entre eux. Il fut un temps où la fécondité naturelle de la terre paraissait être, et était effectivement, le facteur principal de la richesse, tandis que le travail était en quelque sorte l'aide et le soutien de cette fécondité. En notre temps, le rôle du travail humain devient un facteur toujours plus important pour la production des richesses immatérielles et matérielles ; en outre, il paraît évident que le travail d'un homme s'imbrique naturellement dans celui d'autres hommes. Plus que jamais aujourd'hui, travailler, c'est travailler avec les autres ettravailler pour les autres : c'est faire quelque chose pour quelqu'un. Le travail est d'autant plus fécond et productif que l'homme est plus capable de connaître les ressources productives de la terre et de percevoir quels sont les besoins profonds de l'autre pour qui le travail est fourni.
32. Mais, à notre époque, il existe une autre forme de propriété et elle a une importance qui n'est pas inférieure à celle de la terre : c'est la propriété de la connaissance, de la technique et du savoir. La richesse des pays industrialisés se fonde bien plus sur ce type de propriété que sur celui des ressources naturelles.
On a fait allusion au fait que l'homme travaille avec les autres hommes, prenant part à un « travail social » qui s'étend dans des cercles de plus en plus larges. En règle générale, celui qui produit un objet le fait, non seulement pour son usage personnel, mais aussi pour que d'autres puissent s'en servir après avoir payé le juste prix, convenu d'un commun accord dans une libre négociation. Or, la capacité de connaître en temps utile les besoins des autres hommes et l'ensemble des facteurs de production les plus aptes à les satisfaire, c'est précisément une autre source importante de richesse dans la société moderne. Du reste, beaucoup de biens ne peuvent être produits de la manière qui convient par le travail d'un seul individu, mais ils requièrent la collaboration de nombreuses personnes au même objectif. Organiser un tel effort de production, planifier sa durée, veiller à ce qu'il corresponde positivement aux besoins à satisfaire en prenant les risques nécessaires, tout cela constitue aussi une source de richesses dans la société actuelle. Ainsi devient toujours plus évident et déterminant le rôle du travail humain maîtrisé et créatif et, comme part essentielle de ce travail, celui de la capacité d'initiative et d'entreprise (70).
Il faut considérer avec une attention favorable ce processus qui met en lumière concrètement un enseignement sur la personne que le christianisme a constamment affirmé. En effet, avec la terre, la principale ressource de l'homme, c'est l'homme lui-même. C'est son intelligence qui lui fait découvrir les capacités productives de la terre et les multiples manières dont les besoins humains peuvent être satisfaits. C'est son travail maîtrisé, dans une collaboration solidaire, qui permet la création de communautés de travail toujours plus larges et sûres pour accomplir la transformation du milieu naturel et du milieu humain lui-même. Entrent dans ce processus d'importantes vertus telles que l'application, l'ardeur au travail, la prudence face aux risques raisonnables à prendre, la confiance méritée et la fidélité dans les rapports interpersonnels, l'énergie dans l'exécution de décisions difficiles et douloureuses mais nécessaires pour le travail commun de l'entreprise et pour faire face aux éventuels renversements de situations.
L'économie moderne de l'entreprisecomporte des aspects positifs dont la source est la liberté de la personne qui s'exprime dans le domaine économique comme en beaucoup d'autres. En effet, l'économie est un secteur parmi les multiples formes de l'activité humaine, et dans ce secteur, comme en tout autre, le droit à la liberté existe, de même que le devoir d'en faire un usage responsable. Mais il importe de noter qu'il y a des différences caractéristiques entre ces tendances de la société moderne et celles du passé même récent. Si, autrefois, le facteur décisif de la production était la terre, et si, plus tard, c'était le capital, compris comme l'ensemble des machines et des instruments de production, aujourd'hui le facteur décisif est de plus en plus l'homme lui-même, c'est-à-dire sa capacité de connaissance qui apparaît dans le savoir scientifique, sa capacité d'organisation solidaire et sa capacité de saisir et de satisfaire les besoins des autres.
33. On ne peut toutefois omettre de dénoncer les risques et les problèmes liés à ce type d'évolution. En effet, de nombreux hommes, et sans doute la grande majorité, ne disposent pas aujourd'hui des moyens d'entrer, de manière efficace et digne de l'homme, à l'intérieur d'un système d'entreprise dans lequel le travail occupe une place réellement centrale. Ils n'ont la possibilité ni d'acquérir les connaissances de base qui permettent d'exprimer leur créativité et de développer leurs capacités, ni d'entrer dans le réseau de connaissances et d'intercommunications qui leur permettraient de voir apprécier et utiliser leurs qualités. En somme, s'ils ne sont pas exploités, ils sont sérieusement marginalisés ; et le développement économique se poursuit, pour ainsi dire, au-dessus de leur tête, quand il ne va pas jusqu'à restreindre le champ déjà étroit de leurs anciennes économies de subsistance. Incapables de résister à la concurrence de produits obtenus avec des méthodes nouvelles et répondant aux besoins qu'ils satisfaisaient antérieurement dans le cadre d'organisations traditionnelles, alléchés par la splendeur d'une opulence inaccessible pour eux, et en même temps pressés par la nécessité, ces hommes peuplent les villes du Tiers-Monde où ils sont souvent déracinés culturellement et où ils se trouvent dans des situations précaires qui leur font violence, sans possibilité d'intégration. On ne reconnaît pas en fait leur dignité ni leurs capacités humaines positives, et, parfois, on cherche à éliminer leur présence du cours de l'histoire en leur imposant certaines formes de contrôle démographique contraires à la dignité humaine.
Beaucoup d'autres hommes, bien qu'ils ne soient pas tout à fait marginalisés, vivent dans des conditions telles que la lutte pour survivre est de prime nécessité, alors que sont encore en vigueur les pratiques du capitalisme des origines, dans une situation dont la « cruauté » n'a rien à envier à celle des moments les plus noirs de la première phase de l'industrialisation. Dans d'autres cas, c'est encore la terre qui est l'élément central du processus économique, et ceux qui la cultivent, empêchés de la posséder, sont réduits à des conditions de demi-servitude (71). Dans ces cas, on peut parler, aujourd'hui comme au temps de Rerum novarum, d'une exploitation inhumaine. Malgré les changements importants survenus dans les sociétés les plus avancées, les déficiences humaines du capitalisme sont loin d'avoir disparu, et la conséquence en est que les choses matérielles l'emportent sur les hommes ; et plus encore, pour les pauvres, s'est ajoutée à la pénurie de biens matériels celle du savoir et des connaissances qui les empêche de sortir de leur état d'humiliante subordination.
Malheureusement, la grande majorité des habitants du Tiers-Monde vit encore dans de telles conditions. Il serait cependant inexact de comprendre le Tiers- Monde dans un sens uniquement géographique. Dans certaines régions et dans certains secteurs sociaux de ce « Monde », des processus de développement ont été mis en œuvre, centrés moins sur la valorisation des ressources matérielles que sur celle des « ressources humaines ».
Il n'y a pas très longtemps, on soutenait que le développement supposait, pour les pays les plus pauvres, qu'ils restent isolés du marché mondial et ne comptent que sur leurs propres forces. L'expérience de ces dernières années a montré que les pays qui se sont exclus des échanges généraux de l'activité économique sur le plan international ont connu la stagnation et la régression, et que le développement a bénéficié aux pays qui ont réussi à y entrer. Il semble donc que le problème essentiel soit d'obtenir un accès équitable au marché international, fondé non sur le principe unilatéral de l'exploitation des ressources naturelles, mais sur la valorisation des ressources humaines (72).
Mais certains aspects caractéristiques du Tiers- Monde apparaissent aussi dans les pays développés où la transformation incessante des modes de production et des types de consommation dévalorise des connaissances acquises et des compétences professionnelles confirmées, ce qui exige un effort continu de mise à jour et de recyclage. Ceux qui ne réussissent pas à suivre le rythme peuvent facilement être marginalisés, comme le sont, en même temps qu'eux, les personnes âgées, les jeunes incapables de bien s'insérer dans la vie sociale, ainsi que, d'une manière générale, les sujets les plus faibles et ce qu'on appelle le Quart- Monde. Dans ces conditions, la situation de la femme est loin d'être facile.
34. Il semble que, à l'intérieur de chaque pays comme dans les rapports internationaux, le marché libresoit l'instrument le plus approprié pour répartir les ressources et répondre efficacement aux besoins. Toutefois, cela ne vaut que pour les besoins « solvables», parce que l'on dispose d'un pouvoir d'achat, et pour les ressources qui sont « vendables », susceptibles d'être payées à un juste prix. Mais il y a de nombreux besoins humains qui ne peuvent être satisfaits par le marché. C'est un strict devoir de justice et de vérité de faire en sorte que les besoins humains fondamentaux ne restent pas insatisfaits et que ne périssent pas les hommes qui souffrent de ces carences. En outre, il faut que ces hommes dans le besoin soient aidés à acquérir des connaissances, à entrer dans les réseaux de relations, à développer leurs aptitudes pour mettre en valeur leurs capacités et leurs ressources personnelles. Avant même la logique des échanges à parité et des formes de la justice qui les régissent, il y a un certain dû à l'homme parce qu'il est homme, en raison de son éminente dignité. Ce dû comporte inséparablement la possibilité de survivre et celle d'apporter une contribution active au bien commun de l'humanité.
Les objectifs énoncés par Rerum novarum pour éviter de ramener le travail de l'homme et l'homme lui-même au rang d'une simple marchandise gardent toute leur valeur dans le contexte du Tiers-Monde, et, dans certains cas, ils restent encore un but à atteindre : un salaire suffisant pour faire vivre la famille, des assurances sociales pour la vieillesse et le chômage, une réglementation convenable des conditions de travail.
35. Tout cela constitue un champ d'action vaste et fécond pour l'engagement et les luttes, au nom de la justice, des syndicats et des autres organisations de travailleurs qui défendent les droits de ces derniers et protègent leur dignité, alors qu'ils remplissent en même temps une fonction essentielle d'ordre culturel, en vue de les faire participer de plein droit et honorablement à la vie de la nation et de les aider à progresser sur la voie de leur développement.
Dans ce sens, on peut parler à juste titre de lutte contre un système économique entendu comme méthode pour assurer la primauté absolue du capital, de la propriété des instruments de production et de la terre sur la liberté et la dignité du travail de l'homme (73). En luttant contre ce système, on ne peut lui opposer, comme modèle de substitution, le système socialiste, qui se trouve être en fait un capitalisme d'Etat, mais on peut opposer une société du travail libre, de l'entreprise et de la participation. Elle ne s'oppose pas au marché, mais demande qu'il soit dûment contrôlé par les forces sociales et par l'Etat, de manière à garantir la satisfaction des besoins fondamentaux de toute la société.
L'Eglise reconnaît le rôle pertinent du profit comme indicateur du bon fonctionnement de l'entreprise. Quand une entreprise génère du profit, cela signifie que les facteurs productifs ont été dûment utilisés et les besoins humains correspondants convenablement satisfaits. Cependant, le profit n'est pas le seul indicateur de l'état de l'entreprise. Il peut arriver que les comptes économiques soient satisfaisants et qu'en même temps les hommes qui constituent le patrimoine le plus précieux de l'entreprise soient humiliés et offensés dans leur dignité. Non seulement cela est moralement inadmissible, mais cela ne peut pas ne pas entraîner par la suite des conséquences négatives même pour l'efficacité économique de l'entreprise. En effet, le but de l'entreprise n'est pas uniquement la production du profit, mais l'existence même de l'entreprise comme communauté de personnes qui, de différentes manières, recherchent la satisfaction de leurs besoins fondamentaux et qui constituent un groupe particulier au service de la société tout entière. Le profit est un régulateur dans la vie de l'établissement mais il n'en est pas le seul ; il faut y ajouter la prise en compte d'autres facteurs humains et moraux qui, à long terme, sont au moins aussi essentiels pour la vie de l'entreprise.
On a vu que l'on ne peut accepter l'affirmation selon laquelle la défaite du « socialisme réel », comme on l'appelle, fait place au seul modèle capitaliste d'organisation économique. Il faut rompre les barrières et les monopoles qui maintiennent de nombreux peuples en marge du développement, assurer à tous les individus et à toutes les nations les conditions élémentaires qui permettent de participer au développement. Cet objectif requiert des efforts concertés et responsables de la part de toute la communauté internationale. Il convient que les pays les plus puissants sachent donner aux plus pauvres des possibilités d'insertion dans la vie internationale et que les pays les plus démunis sachent saisir ces possibilités, en consentant les efforts et les sacrifices nécessaires, en assurant la stabilité de leur organisation politique et de leur économie, la sûreté dans leurs perspectives d'avenir, l'augmentation du niveau des compétences de leurs travailleurs, la formation de dirigeants d'entreprises efficaces et conscients de leurs responsabilités.
Actuellement, sur les efforts constructifs qui sont accomplis dans ce domaine pèse le problème de la dette extérieure des pays les plus pauvres, problème encore en grande partie non résolu. Le principe que les dettes doivent être payées est assurément juste ; mais il n'est pas licite de demander et d'exiger un paiement quand cela reviendrait à imposer en fait des choix politiques de nature à pousser à la faim et au désespoir des populations entières. On ne saurait prétendre au paiement des dettes contractées si c'est au prix de sacrifices insupportables. Dans ces cas, il est nécessaire — comme du reste cela est entrain d'être partiellement fait — de trouver des modalités d'allégement, de report ou même d'extinction de la dette, compatibles avec le droit fondamental des peuples à leur subsistance et à leur progrès.
36. Il convient maintenant d'attirer l'attention sur les problèmes spécifiques et sur les menaces qui surgissent à l'intérieur des économies les plus avancées et qui sont liés à leurs caractéristiques particulières. Dans les étapes antérieures du développement, l'homme a toujours vécu sous l'emprise de la nécessité. Ses besoins étaient réduits, définis en quelque sorte par les seules structures objectives de sa constitution physique, et l'activité économique était conçue pour les satisfaire. Il est clair qu'aujourd'hui, le problème n'est pas seulement de lui offrir une quantité suffisante de biens, mais de répondre à une demande de qualité : qualité des marchandises à produire et à consommer ; qualité des services dont on doit disposer ; qualité du milieu et de la vie en général.
La demande d'une existence plus satisfaisante qualitativement et plus riche est en soi légitime. Mais on ne peut que mettre l'accent sur les responsabilités nouvelles et sur les dangers liés à cette étape de l'histoire. Dans la manière dont surgissent les besoins nouveaux et dont ils sont définis, intervient toujours une conception plus ou moins juste de l'homme et de son véritable bien. Dans les choix de la production et de la consommation, se manifeste une culture déterminée qui présente une conception d'ensemble de la vie. C'est là qu'apparaît lephénomène de la consommation. Quand on définit de nouveaux besoins et de nouvelles méthodes pour les satisfaire, il est nécessaire qu'on s'inspire d'une image intégrale de l'homme qui respecte toutes les dimensions de son être et subordonne les dimensions physiques et instinctives aux dimensions intérieures et spirituelles. Au contraire, si l'on se réfère directement à ses instincts et si l'on fait abstraction d'une façon ou de l'autre de sa réalité personnelle, consciente et libre, cela peut entraîner des habitudes de consommationet des styles de vie objectivement illégitimes, et souvent préjudiciables à sa santé physique et spirituelle. Le système économique ne comporte pas dans son propre cadre des critères qui permettent de distinguer correctement les formes nouvelles et les plus élevées de satisfaction des besoins humains et les besoins nouveaux induits qui empêchent la personnalité de parvenir à sa maturité. La nécessité et l'urgence apparaissent donc d'un vaste travail éducatif et culturel qui comprenne l'éducation des consommateurs à un usage responsable de leur pouvoir de choisir, la formation d'un sens aigu des responsabilités chez les producteurs, et surtout chez les professionnels des moyens de communication sociale, sans compter l'intervention nécessaire des pouvoirs publics.
La drogue constitue un cas évident de consommation artificielle, préjudiciable à la santé et à la dignité de l'homme, et, certes, difficile à contrôler. Sa diffusion est le signe d'un grave dysfonctionnement du système social qui suppose une « lecture » matérialiste et, en un sens, destructrice des besoins humains. Ainsi, les capacités d'innovation de l'économie libérale finissent par être mises en oeuvre de manière unilatérale et inappropriée. La drogue, et de même la pornographie et d'autres formes de consommation, exploitant la fragilité des faibles, cherchent à remplir le vide spirituel qui s'est produit.
Il n'est pas mauvais de vouloir vivre mieux, mais ce qui est mauvais, c'est le style de vie qui prétend être meilleur quand il est orienté vers l'avoir et non vers l'être, et quand on veut avoir plus, non pour être plus mais pour consommer l'existence avec une jouissance qui est à elle-même sa fin (75). Il est donc nécessaire de s'employer à modeler un style de vie dans lequel les éléments qui déterminent les choix de consommation, d'épargne et d'investissement soient la recherche du vrai, du beau et du bon, ainsi que la communion avec les autres hommes pour une croissance commune. A ce propos, je ne puis m'en tenir à un rappel du devoir de la charité, c'est-à-dire du devoir de donner de son « superflu » et aussi parfois de son « nécessaire » pour subvenir à la vie du pauvre. Je pense au fait que même le choix d'investir en un lieu plutôt que dans un autre, dans un secteur de production plutôt qu'en un autre, est toujours un choix moral et culturel. Une fois réunies certaines conditions nécessaires dans les domaines de l'économie et de la stabilité politique, la décision d'investir, c'est-à-dire d'offrir à un peuple l'occasion de mettre en valeur son travail, est conditionnée également par une attitude de sympathie et par la confiance en la Providence qui révèlent la qualité humaine de celui qui prend la décision.
37. A côté du problème de la consommation, la question de l'écologie, qui lui est étroitement connexe, inspire autant d'inquiétude. L'homme, saisi par le désir d'avoir et de jouir plus que par celui d'être et de croître, consomme d'une manière excessive et désordonnée les ressources de la terre et sa vie même. A l'origine de la destruction insensée du milieu naturel, il y a une erreur anthropologique, malheureusement répandue à notre époque. L'homme, qui découvre sa capacité de transformer et en un sens de créer le monde par son travail, oublie que cela s'accomplit toujours à partir du premier don originel des choses fait par Dieu. Il croit pouvoir disposer arbitrairement de la terre, en la soumettant sans mesure à sa volonté, comme si elle n'avait pas une forme et une destination antérieures que Dieu lui a données, que l'homme peut développer mais qu'il ne doit pas trahir. Au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l'œuvre de la création, l'homme se substitue à Dieu et, ainsi, finit par provoquer la révolte de la nature, plus tyrannisée que gouvernée par lui (76).
En cela, on remarque avant tout la pauvreté ou la mesquinerie du regard de l'homme, plus animé par le désir de posséder les choses que de les considérer par rapport à la vérité, et qui ne prend pas l'attitude désintéressée, faite de gratuité et de sens esthétique, suscitée par l'émerveillement pour l'être et pour la splendeur qui permet de percevoir dans les choses visibles le message de Dieu invisible qui les a créées. Dans ce domaine, l'humanité d'aujourd'hui doit avoir conscience de ses devoirs et de ses responsabilités envers les générations à venir.
38. En dehors de la destruction irrationnelle du milieu naturel, il faut rappeler ici la destruction encore plus grave du milieu humain, à laquelle on est cependant loin d'accorder l'attention voulue. Alors que l'on se préoccupe à juste titre, même si on est bien loin de ce qui serait nécessaire, de sauvegarder les habitats naturels des différentes espèces animales menacées d'extinction, parce qu'on se rend compte que chacune d'elles apporte sa contribution particulière à l'équilibre général de la terre, on s'engage trop peu dans la sauvegarde des conditions morales d'une « écologie humaine » authentique. Non seulement la terre a été donnée par Dieu à l'homme qui doit en faire usage dans le respect de l'intention primitive, bonne, dans laquelle elle a été donnée, mais l'homme, lui aussi, est donné par Dieu à lui-même et il doit donc respecter la structure naturelle et morale dont il a été doté. Dans ce contexte, il faut mentionner les problèmes graves posés par l'urbanisation moderne, la nécessité d'un urbanisme soucieux de la vie des personnes, de même que l'attention qu'il convient de porter à une « écologie sociale » du travail.
L'homme reçoit de Dieu sa dignité essentielle et, avec elle, la capacité de transcender toute organisation de la société dans le sens de la vérité et du bien. Toutefois, il est aussi conditionné par la structure sociale dans laquelle il vit, par l'éducation reçue et par son milieu. Ces éléments peuvent faciliter ou entraver sa vie selon la vérité. Les décisions grâce auxquelles se constitue un milieu humain peuvent créer des structures de péché spécifiques qui entravent le plein épanouissement de ceux qu'elles oppriment de différentes manières. Démanteler de telles structures et les remplacer par des formes plus authentiques de convivialité constitue une tâche qui requiert courage et patience (77).
39. La première structure fondamentale pour une « écologie humaine » est la famille, au sein de laquelle l'homme reçoit des premières notions déterminantes concernant la vérité et le bien, dans laquelle il apprend ce que signifie aimer et être aimé et, par conséquent, ce que veut dire concrètement être une personne. On pense ici à la famille fondée sur le mariage, où le don de soi réciproque de l'homme et de la femme crée un milieu de vie dans lequel l'enfant peut naître et épanouir ses capacités, devenir conscient de sa dignité et se préparer à affronter son destin unique et irremplaçable. Il arrive souvent, au contraire, que l'homme se décourage de réaliser les conditions authentiques de la reproduction humaine, et il est amené à se considérer lui-même et à considérer sa propre vie comme un ensemble de sensations à expérimenter et non comme une oeuvre à accomplir. Il en résulte un manque de liberté qui fait renoncer au devoir de se lier dans la stabilité avec une autre personne et d'engendrer des enfants, ou bien qui amène à considérer ceux-ci comme une de ces nombreuses « choses » que l'on peut avoir ou ne pas avoir, au gré de ses goûts, et qui entrent en concurrence avec d'autres possibilités.
Il faut en revenir à considérer la famille comme le sanctuaire de la vie. En effet, elle est sacrée, elle est le lieu où la vie, don de Dieu, peut être convenablement accueillie et protégée contre les nombreuses attaques auxquelles elle est exposée, le lieu où elle peut se développer suivant les exigences d'une croissance humaine authentique. Contre ce qu'on appelle la culture de la mort, la famille constitue le lieu de la culture de la vie.
Dans ce domaine, le génie de l'homme semble s'employer plus à limiter, à supprimer ou à annuler les sources de la vie, en recourant même à l'avortement, malheureusement très diffusé dans le monde, qu'à défendre et à élargir les possibilités de la vie elle-même. Dans l'encyclique Sollicitudo rei socialis, ont été dénoncées les campagnes systématiques contre la natalité qui, fondées sur une conception faussée du problème démographique dans un climat de « manque absolu de respect pour la liberté de décision des personnes intéressées », les soumettent fréquemment « à d'intolérables pressions [...] pour les plier à cette forme nouvelle d'oppression » (78). Il s'agit de politiques qui étendent leur champ d'action avec des techniques nouvelles jusqu'à parvenir, comme dans une « guerre chimique », à empoisonner la vie de millions d'êtres humains sans défense.
Ces critiques s'adressent moins à un système économique qu'à un système éthique et culturel. En effet, l'économie n'est qu'un aspect et une dimension dans la complexité de l'activité humaine. Si elle devient un absolu, si la production et la consommation des marchandises finissent par occuper le centre de la vie sociale et deviennent la seule valeur de la société, soumise à aucune autre, il faut en chercher la cause non seulement et non tant dans le système économique lui-même, mais dans le fait que le système socio-culturel, ignorant la dimension éthique et religieuse, s'est affaibli et se réduit alors à la production des biens et des services (79).
On peut résumer tout cela en réaffirmant, une fois encore, que la liberté économique n'est qu'un élément de la liberté humaine. Quand elle se rend autonome, quand l'homme est considéré plus comme un producteur ou un consommateur de biens que comme un sujet qui produit et consomme pour vivre, alors elle perd sa juste relation avec la personne humaine et finit par l'aliéner et par l'opprimer (80).
40. L'Etat a le devoir d'assurer la défense et la protection des biens collectifs que sont le milieu naturel et le milieu humain dont la sauvegarde ne peut être obtenue par les seuls mécanismes du marché. Comme, aux temps de l'ancien capitalisme, l'Etat avait le devoir de défendre les droits fondamentaux du travail, de même, avec le nouveau capitalisme, il doit, ainsi que la société, défendre les biens collectifsqui, entre autres, constituent le cadre à l'intérieur duquel il est possible à chacun d'atteindre légitimement ses fins personnelles.
On retrouve ici une nouvelle limite du marché : il y a des besoins collectifs et qualitatifs qui ne peuvent être satisfaits par ses mécanismes ; il y a des nécessités humaines importantes qui échappent à sa logique ; il y a des biens qui, en raison de leur nature, ne peuvent ni ne doivent être vendus ou achetés. Certes, les mécanismes du marché présentent des avantages solides : entre autres, ils aident à mieux utiliser les ressources ; ils favorisent les échanges de produits ; et, surtout, ils placent au centre la volonté et les préférences de la personne, qui, dans un contrat, rencontrent celles d'une autre personne. Toutefois, ils comportent le risque d'une « idolâtrie » du marché qui ignore l'existence des biens qui, par leur nature, ne sont et ne peuvent être de simples marchandises.
41. Le marxisme a critiqué les sociétés capitalistes bourgeoises, leur reprochant d'aliéner l'existence humaine et d'en faire une marchandise. Ce reproche se fonde assurément sur une conception erronée et inappropriée de l'aliénation, qui la fait dépendre uniquement de la sphère des rapports de production et de propriété, c'est-à-dire qu'il lui attribue un fondement matérialiste et, de plus, nie la légitimité et le caractère positif des relations du marché même dans leur propre domaine. On en vient ainsi à affirmer que l'aliénation ne peut être éliminée que dans une société de type collectiviste. Or, l'expérience historique des pays socialistes a tristement fait la preuve que le collectivisme non seulement ne supprime pas l'aliénation, mais l'augmente plutôt, car il y ajoute la pénurie des biens nécessaires et l'inefficacité économique.
L'expérience historique de l'Occident, de son côté, montre que, même si l'analyse marxiste de l'aliénation et ses fondements sont faux, l'aliénation avec la perte du sens authentique de l'existence est également une réalité dans les sociétés occidentales. On le constate au niveau de la consommation lorsqu'elle engage l'homme dans un réseau de satisfactions superficielles et fausses, au lieu de l'aider à faire l'expérience authentique et concrète de sa personnalité. Elle se retrouve aussi dans le travail, lorsqu'il est organisé de manière à ne valoriser que ses productions et ses revenus sans se soucier de savoir si le travailleur, par son travail, s'épanouit plus ou moins en son humanité, selon qu'augmente l'intensité de sa participation à une véritable communauté solidaire, ou bien que s'aggrave son isolement au sein d'un ensemble de relations caractérisé par une compétitivité exaspérée et des exclusions réciproques, où il n'est considéré que comme un moyen, et non comme une fin.
Il est nécessaire de rapprocher le concept d'aliénation de la vision chrétienne des choses, pour y déceler l'inversion entre les moyens et les fins : quand il ne reconnaît pas la valeur et la grandeur de la personne en lui-même et dans l'autre, l'homme se prive de la possibilité de jouir convenablement de son humanité et d'entrer dans les relations de solidarité et de communion avec les autres hommes pour lesquelles Dieu l'a créé. En effet, c'est par le libre don de soi que l'homme devient authentiquement lui-même (81), et ce don est rendu possible parce que la personne humaine est essentiellement « capable de transcendance ». L'homme ne peut se donner à un projet seulement humain sur la réalité, à un idéal abstrait ou à de fausses utopies. En tant que personne, il peut se donner à une autre personne ou à d'autres personnes et, finalement, à Dieu qui est l'auteur de son être et qui, seul, peut accueillir pleinement ce don (82). L'homme est aliéné quand il refuse de se transcender et de vivre l'expérience du don de soi et de la formation d'une communauté humaine authentique orientée vers sa fin dernière qu'est Dieu. Une société est aliénée quand, dans les formes de son organisation sociale, de la production et de la consommation, elle rend plus difficile la réalisation de ce don et la constitution de cette solidarité entre hommes.
Dans la société occidentale, l'exploitation a été surmontée, du moins sous la forme analysée et décrite par Karl Marx. Cependant, l'aliénation n'a pas été surmontée dans les diverses formes d'exploitation lorsque les hommes tirent profit les uns des autres et que, avec la satisfaction toujours plus raffinée de leurs besoins particuliers et secondaires, ils se rendent sourds à leurs besoins essentiels et authentiques qui doivent régir aussi les modalités de la satisfaction des autres besoins (83). L'homme ne peut pas être libre s'il se préoccupe seulement ou surtout de l'avoir et de la jouissance, au point de n'être plus capable de dominer ses instincts et ses passions, ni de les unifier ou de les maîtriser par l'obéissance à la vérité. L'obéissance à la vérité de Dieu et de l'hommeest pour lui la condition première de la liberté et lui permet d'ordonner ses besoins, ses désirs et les manières de les satisfaire suivant une juste hiérarchie, de telle sorte que la possession des choses soit pour lui un moyen de grandir. Cette croissance peut être entravée du fait de la manipulation par les médias qui imposent, au moyen d'une insistance bien orchestrée, des modes et des mouvements d'opinion, sans qu'il soit possible de soumettre à une critique attentive les prémisses sur lesquelles ils sont fondés.
42. En revenant maintenant à la question initiale, peut-on dire que, après l'échec du communisme, le capitalisme est le système social qui l'emporte et que c'est vers lui que s'orientent les efforts des pays qui cherchent à reconstruire leur économie et leur société ? Est-ce ce modèle qu'il faut proposer aux pays du Tiers-Monde qui cherchent la voie du vrai progrès de leur économie et de leur société civile ?
La réponse est évidemment complexe. Si sous le nom de « capitalisme » on désigne un système économique qui reconnaît le rôle fondamental et positif de l'entreprise, du marché, de la propriété privée et de la responsabilité qu'elle implique dans les moyens de production, de la libre créativité humaine dans le secteur économique, la réponse est sûrement positive, même s'il serait peut-être plus approprié de parler d'« économie d'entreprise », ou d'« économie de marché », ou simplement d'« économie libre ». Mais si par « capitalisme » on entend un système où la liberté dans le domaine économique n'est pas encadrée par un contexte juridique ferme qui la met au service de la liberté humaine intégrale et la considère comme une dimension particulière de cette dernière, dont l'axe est d'ordre éthique et religieux, alors la réponse est nettement négative.
La solution marxiste a échoué, mais des phénomènes de marginalisation et d'exploitation demeurent dans le monde, spécialement dans le Tiers-Monde, de même que des phénomènes d'aliénation humaine, spécialement dans les pays les plus avancés, contre lesquels la voix de l'Eglise s'élève avec fermeté. Des foules importantes vivent encore dans des conditions de profonde misère matérielle et morale. Certes, la chute du système communiste élimine dans de nombreux pays un obstacle pour le traitement approprié et réaliste de ces problèmes, mais cela ne suffit pas à les résoudre. Il y a même un risque de voir se répandre une idéologie radicale de type capitaliste qui refuse jusqu'à leur prise en considération, admettant a priori que toute tentative d'y faire face directement est vouée à l'insuccès, et qui, par principe, en attend la solution du libre développement des forces du marché.
43. L'Eglise n'a pas de modèle à proposer. Les modèles véritables et réellement efficaces ne peuvent être conçus que dans le cadre des différentes situations historiques, par l'effort de tous les responsables qui font face aux problèmes concrets sous tous leurs aspects sociaux, économiques, politiques et culturels imbriqués les uns avec les autres (84). Face à ces responsabilités, l'Eglise présente, comme orientation intellectuelle indispensable, sa doctrine sociale qui — ainsi qu'il a été dit — reconnaît le caractère positif du marché et de l'entreprise, mais qui souligne en même temps la nécessité de leur orientation vers le bien commun. Cette doctrine reconnaît aussi la légitimité des efforts des travailleurs pour obtenir le plein respect de leur dignité et une participation plus large à la vie de l'entreprise, de manière que, tout en travaillant avec d'autres et sous la direction d'autres personnes, ils puissent en un sens travailler « à leur compte» (85), en exerçant leur intelligence et leur liberté.
Le développement intégral de la personne humaine dans le travail ne contredit pas, mais favorise plutôt, une meilleure productivité et une meilleure efficacité du travail lui-même, même si cela peut affaiblir les centres du pouvoir établi. L'entreprise ne peut être considérée seulement comme une « société de capital » ; elle est en même temps une « société de personnes » dans laquelle entrent de différentes manières et avec des responsabilités spécifiques ceux qui fournissent le capital nécessaire à son activité et ceux qui y collaborent par leur travail. Pour atteindre ces objectifs, un vaste mouvement associatif des travailleurs est encore nécessaire, dont le but est la libération et la promotion intégrale de la personne.
On a relu, à la lumière des « choses nouvelles » d'aujourd'hui, le rapport entre la propriété individuelle, ou privée, et la destination universelle des biens. L'homme s'épanouit par son intelligence et sa liberté, et, ce faisant, il prend comme objet et comme instrument les éléments du monde et il se les approprie. Le fondement du droit d'initiative et de propriété individuelle réside dans cette nature de son action. Par son travail, l'homme se dépense non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres et avec les autres : chacun collabore au travail et au bien d'autrui. L'homme travaille pour subvenir aux besoins de sa famille, de la communauté à laquelle il appartient, de la nation et, en définitive, de l'humanité entière (86). En outre, il collabore au travail des autres personnes qui exercent leur activité dans la même entreprise, de même qu'au travail des fournisseurs et à la consommation des clients, dans une chaîne de solidarité qui s'étend progressivement. La propriété des moyens de production, tant dans le domaine industriel qu'agricole, est juste et légitime, si elle permet un travail utile ; au contraire, elle devient illégitime quand elle n'est pas valorisée ou quand elle sert à empêcher le travail des autres pour obtenir un gain qui ne provient pas du développement d'ensemble du travail et de la richesse sociale, mais plutôt de leur limitation, de l'exploitation illicite, de la spéculation et de la rupture de la solidarité dans le monde du travail (87). Ce type de propriété n'a aucune justification et constitue un abus devant Dieu et devant les hommes.
L'obligation de gagner son pain à la sueur de son front suppose en même temps un droit. Une société dans laquelle ce droit serait systématiquement nié, dans laquelle les mesures de politique économique ne permettraient pas aux travailleurs d'atteindre un niveau satisfaisant d'emploi, ne peut ni obtenir sa légitimation éthique ni assurer la paix sociale. De même que la personne se réalise pleinement dans le libre don de soi, de même la propriété se justifie moralement dans la création, suivant les modalités et les rythmes appropriés, de possibilités d'emploi et de développement humain pour tous.
V. L'ETAT ET LA CULTURE
44. Léon XIII n'ignorait pas qu'il faut une saine théorie de l'Etat pour assurer le développement normal des activités humaines, des activités spirituelles et matérielles, indispensables les unes et les autres (89). A ce sujet, dans un passage de Rerum novarum, il expose l'organisation de la société en trois pouvoirs — législatif, exécutif et judiciaire —, et cela représentait alors une nouveauté dans l'enseignement de l'Eglise (90). Cette structure reflète une conception réaliste de la nature sociale de l'homme qui requiert une législation adaptée pour protéger la liberté de tous. Dans cette perspective, il est préférable que tout pouvoir soit équilibré par d'autres pouvoirs et par d'autres compétences qui le maintiennent dans de justes limites. C'est là le principe de l'« Etat de droit », dans lequel la souveraineté appartient à la loi et non pas aux volontés arbitraires des hommes.
A l'époque moderne, contre cette conception s'est dressé le totalitarisme qui, dans sa forme marxiste-léniniste, considère que quelques hommes, en vertu d'une connaissance plus approfondie des lois du développement de la société, ou à cause de leur appartenance particulière de classe et de leur proximité des sources les plus vives de la conscience collective, sont exempts d'erreur et peuvent donc s'arroger l'exercice d'un pouvoir absolu. Il faut ajouter que le totalitarisme naît de la négation de la vérité au sens objectif du terme : s'il n'existe pas de vérité transcendante, par l'obéissance à laquelle l'homme acquiert sa pleine identité, dans ces conditions, il n'existe aucun principe sûr pour garantir des rapports justes entre les hommes. Leurs intérêts de classe, de groupe ou de nation les opposent inévitablement les uns aux autres. Si la vérité transcendante n'est pas reconnue, la force du pouvoir triomphe, et chacun tend à utiliser jusqu'au bout les moyens dont il dispose pour faire prévaloir ses intérêts ou ses opinions, sans considération pour les droits des autres. Alors l'homme n'est respecté que dans la mesure où il est possible de l'utiliser aux fins d'une prépondérance égoïste. Il faut donc situer la racine du totalitarisme moderne dans la négation de la dignité transcendante de la personne humaine, image visible du Dieu invisible et, précisément pour cela, de par sa nature même, sujet de droits que personne ne peut violer, ni l'individu, ni le groupe, ni la classe, ni la nation, ni l'Etat. La majorité d'un corps social ne peut pas non plus le faire, en se dressant contre la minorité pour la marginaliser, l'opprimer, l'exploiter, ou pour tenter de l'anéantir (91).
45. La culture et la pratique du totalitarisme comportent aussi la négation de l'Eglise. L'Etat, ou le parti, qui considère qu'il peut réaliser dans l'histoire le bien absolu et qui se met lui-même au-dessus de toutes les valeurs, ne peut tolérer que l'on défende un critère objectif du bien et du mal qui soit différent de la volonté des gouvernants et qui, dans certaines circonstances, puisse servir à porter un jugement sur leur comportement. Cela explique pourquoi le totalitarisme cherche à détruire l'Eglise ou du moins à l'assujettir, en en faisant un instrument de son propre système idéologique (92).
L'Etat totalitaire, d'autre part, tend à absorber la nation, la société, la famille, les communautés religieuses et les personnes elles-mêmes. En défendant sa liberté, l'Eglise défend la personne, qui doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes (cf. Ac 5, 29), la famille, les différentes organisations sociales et les nations, réalités qui jouissent toutes d'un domaine propre d'autonomie et de souveraineté.
46. L'Eglise apprécie le système démocratique, comme système qui assure la participation des citoyens aux choix politiques et garantit aux gouvernés la possibilité de choisir et de contrôler leurs gouvernants, ou de les remplacer de manière pacifique lorsque cela s'avère opportun (93). Cependant, l'Eglise ne peut approuver la constitution de groupes dirigeants restreints qui usurpent le pouvoir de l'Etat au profit de leurs intérêts particuliers ou à des fins idéologiques.
Une démocratie authentique n'est possible que dans un Etat de droit et sur la base d'une conception correcte de la personne humaine. Elle requiert la réalisation des conditions nécessaires pour la promotion des personnes, par l'éducation et la formation à un vrai idéal, et aussi l'épanouissement de la « personnalité » de la société, par la création de structures de participation et de coresponsabilité. On tend à affirmer aujourd'hui que l'agnosticisme et le relativisme sceptique représentent la philosophie et l'attitude fondamentale accordées aux formes démocratiques de la vie politique, et que ceux qui sont convaincus de connaître la vérité et qui lui donnent une ferme adhésion ne sont pas dignes de confiance du point de vue démocratique, parce qu'ils n'acceptent pas que la vérité soit déterminée par la majorité, ou bien qu'elle diffère selon les divers équilibres politiques. A ce propos, il faut observer que, s'il n'existe aucune vérité dernière qui guide et oriente l'action politique, les idées et les convictions peuvent être facilement exploitées au profit du pouvoir. Une démocratie sans valeurs se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou sournois, comme le montre l'histoire.
Et l'Eglise n'ignore pas le danger du fanatisme, ou du fondamentalisme, de ceux qui, au nom d'une idéologie qui se prétend scientifique ou religieuse, estiment pouvoir imposer aux autres hommes leur conception de la vérité et du bien. La vérité chrétiennen'est pas de cette nature. N'étant pas une idéologie, la foi chrétienne ne cherche nullement à enfermer dans le cadre d'un modèle rigide la changeante réalité sociale et politique et elle admet que la vie de l'homme se réalise dans l'histoire de manières diverses et imparfaites. Cependant l'Eglise, en réaffirmant constamment la dignité transcendante de la personne, adopte comme règle d'action le respect de la liberté (94).
Mais la liberté n'est pleinement mise en valeur que par l'accueil de la vérité : en un monde sans vérité, la liberté perd sa consistance et l'homme est soumis à la violence des passions et à des conditionnements apparents ou occultes. Le chrétien vit la liberté (cf. Jn 8, 31-32) et il se met au service de la liberté, il propose constamment, en fonction de la nature missionnaire de sa vocation, la vérité qu'il a découverte. Dans le dialogue avec les autres, attentif à tout élément de la vérité qu'il découvre dans l'expérience de la vie et de la culture des personnes et des nations, il ne renoncera pas à affirmer tout ce que sa foi et un sain exercice de la raison lui ont fait connaître.
47. Après la chute du totalitarisme communiste et de nombreux autres régimes totalitaires et de « sécurité nationale », on assiste actuellement, non sans conflits, au succès de l'idéal démocratique dans le monde, allant de pair avec une grande attention et une vive sollicitude pour les droits de l'homme. Mais précisément pour aller dans ce sens, il est nécessaire que les peuples qui sont en train de réformer leurs institutions donnent à la démocratie un fondement authentique et solide grâce à la reconnaissance explicite de ces droits (96). Parmi les principaux, il faut rappeler le droit à la vie dont fait partie intégrante le droit de grandir dans le sein de sa mère après la conception ; puis le droit de vivre dans une famille unie et dans un climat moral favorable au développement de sa personnalité ; le droit d'épanouir son intelligence et sa liberté par la recherche et la connaissance de la vérité ; le droit de participer au travail de mise en valeur des biens de la terre et d'en tirer sa subsistance et celle de ses proches ; le droit de fonder librement une famille, d'accueillir et d'élever des enfants, en exerçant de manière responsable sa sexualité. En un sens, la source et la synthèse de ces droits, c'est la liberté religieuse, entendue comme le droit de vivre dans la vérité de sa foi et conformément à la dignité transcendante de sa personne (97).
Même dans les pays qui connaissent des formes de gouvernement démocratique, ces droits ne sont pas toujours entièrement respectés. Et l'on ne pense pas seulement au scandale de l'avortement, mais aussi aux divers aspects d'une crise des systèmes démocratiques qui semblent avoir parfois altéré la capacité de prendre des décisions en fonction du bien commun. Les requêtes qui viennent de la société ne sont pas toujours examinées selon les critères de la justice et de la moralité, mais plutôt d'après l'influence électorale ou le poids financier des groupes qui les soutiennent. De telles déviations des mœurs politiques finissent par provoquer la défiance et l'apathie, et par entraîner une baisse de la participation politique et de l'esprit civique de la population, qui se sent atteinte et déçue. Il en résulte une incapacité croissante à situer les intérêts privés dans le cadre d'une conception cohérente du bien commun. Celui-ci, en effet, n'est pas seulement la somme des intérêts particuliers, mais il suppose qu'on les évalue et qu'on les harmonise en fonction d'une hiérarchie des valeurs équilibrée et, en dernière analyse, d'une conception correcte de la dignité et des droits de la personne (98).
L'Eglise respecte l'autonomie légitime de l'ordre démocratique et elle n'a pas qualité pour exprimer une préférence de l'une ou l'autre solution institutionnelle ou constitutionnelle. La contribution qu'elle offre à ce titre est justement celle de sa conception de la dignité de la personne qui apparaît en toute plénitude dans le mystère du Verbe incarné (99).
48. Ces considérations d'ordre général rejaillissent également sur le rôle de l'Etat dans le secteur économique. L'activité économique, en particulier celle de l'économie de marché, ne peut se dérouler dans un vide institutionnel, juridique et politique. Elle suppose, au contraire, que soient assurées les garanties des libertés individuelles et de la propriété, sans compter une monnaie stable et des services publics efficaces. Le devoir essentiel de l'Etat est cependant d'assurer ces garanties, afin que ceux qui travaillent et qui produisent puissent jouir du fruit de leur travail et donc se sentir stimulés à l'accomplir avec efficacité et honnêteté. L'un des principaux obstacles au développement et au bon ordre économiques est le défaut de sécurité, accompagné de la corruption des pouvoirs publics et de la multiplication de manières impropres de s'enrichir et de réaliser des profits faciles en recourant à des activités illégales ou purement spéculatives.
L'Etat a par ailleurs le devoir de surveiller et de conduire l'application des droits humains dans le secteur économique ; dans ce domaine, toutefois, la première responsabilité ne revient pas à l'Etat mais aux individus et aux différents groupes ou associations qui composent la société. L'Etat ne pourrait pas assurer directement l'exercice du droit au travail de tous les citoyens sans contrôler toute la vie économique et entraver la liberté des initiatives individuelles. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il n'ait aucune compétence dans ce secteur, comme l'ont affirmé ceux qui prônent l'absence totale de règles dans le domaine économique. Au contraire, l'Etat a le devoir de soutenir l'activité des entreprises en créant les conditions qui permettent d'offrir des emplois, en la stimulant dans les cas où elle reste insuffisante ou en la soutenant dans les périodes de crise.
L'Etat a aussi le droit d'intervenir lorsque des situations particulières de monopole pourraient freiner ou empêcher le développement. Mais, à part ces rôles d'harmonisation et d'orientation du développement, il peut remplir des fonctions de suppléancedans des situations exceptionnelles, lorsque des groupes sociaux ou des ensembles d'entreprises trop faibles ou en cours de constitution ne sont pas à la hauteur de leurs tâches. Ces interventions de suppléance, que justifie l'urgence d'agir pour le bien commun, doivent être limitées dans le temps, autant que possible, pour ne pas enlever de manière stable à ces groupes ou à ces entreprises les compétences qui leur appartiennent et pour ne pas étendre à l'excès le cadre de l'action de l'Etat, en portant atteinte à la liberté économique ou civile.
On a assisté, récemment, à un important élargissement du cadre de ces interventions, ce qui a amené à constituer, en quelque sorte, un Etat de type nouveau, l'« Etat du bien-être ». Ces développements ont eu lieu dans certains Etats pour mieux répondre à beaucoup de besoins, en remédiant à des formes de pauvreté et de privation indignes de la personne humaine. Cependant, au cours de ces dernières années en particulier, des excès ou des abus assez nombreux ont provoqué des critiques sévères de l'Etat du bien-être, que l'on a appelé l'« Etat de l'assistance ». Les dysfonctionnements et les défauts des soutiens publics proviennent d'une conception inappropriée des devoirs spécifiques de l'Etat. Dans ce cadre, il convient de respecter également le principe de subsidiarité: une société d'ordre supérieur ne doit pas intervenir dans la vie interne d'une société d'un ordre inférieur, en lui enlevant ses compétences, mais elle doit plutôt la soutenir en cas de nécessité et l'aider à coordonner son action avec celle des autres éléments qui composent la société, en vue du bien commun (100).
En intervenant directement et en privant la société de ses responsabilités, l'Etat de l'assistance provoque la déperdition des forces humaines, l'hypertrophie des appareils publics, animés par une logique bureaucratique plus que par la préoccupation d'être au service des usagers, avec une croissance énorme des dépenses. En effet, il semble que les besoins soient mieux connus par ceux qui en sont plus proches ou qui savent s'en rapprocher, et que ceux-ci soient plus à même d'y répondre. On ajoutera que souvent certains types de besoins appellent une réponse qui ne soit pas seulement d'ordre matériel mais qui sache percevoir la requête humaine plus profonde. Que l'on pense aussi aux conditions que connaissent les réfugiés, les immigrés, les personnes âgées ou malades, et aux diverses conditions qui requièrent une assistance, comme dans le cas des toxicomanes, toutes personnes qui ne peuvent être efficacement aidées que par ceux qui leur apportent non seulement les soins nécessaires, mais aussi un soutien sincèrement fraternel.
49. Dans ce domaine, l'Eglise, fidèle au commandement du Christ, son Fondateur, a toujours été présente par ses œuvres conçues pour offrir à l'homme dans le besoin un soutien matériel qui ne l'humilie pas et qui ne le réduise pas à l'état de sujet assisté, mais qui l'aide à sortir de ses conditions précaires en l'affermissant dans sa dignité de personne. Dans une fervente action de grâce, il faut souligner que la charité active ne s'est jamais éteinte dans l'Eglise, et même qu'elle connaît aujourd'hui une progression réconfortante sous de multiples formes. A cet égard, une mention particulière est due au phénomène du volontariat que l'Eglise encourage et promeut en demandant à tous leur collaboration pour le soutenir et l'encourager dans ses initiatives.
Pour dépasser la mentalité individualiste répandue aujourd'hui, il faut un engagement concret de solidarité et de charité qui commence à l'intérieur de la famille par le soutien mutuel des époux, puis s'exerce par la prise en charge des générations les unes par les autres. C'est ainsi que la famille se définit comme une communauté de travail et de solidarité. Cependant, il arrive que, lorsque la famille décide de répondre pleinement à sa vocation, elle se trouve privée de l'appui nécessaire de la part de l'Etat, et elle ne dispose pas de ressources suffisantes. Il est urgent de promouvoir non seulement des politiques de la famille, mais aussi des politiques sociales qui aient comme principal objectif la famille elle-même, en l'aidant, par l'affectation de ressources convenables et de moyens efficaces de soutien, tant dans l'éducation des enfants que dans la prise en charge des anciens, afin d'éviter à ces derniers l'éloignement de leur noyau familial et de renforcer les liens entre les générations (101).
A part la famille, d'autres groupes sociaux intermédiaires remplissent des rôles primaires et mettent en œuvre des réseaux de solidarité spécifiques. Ces groupes acquièrent la maturité de vraies communautés de personnes et innervent le tissu social, en l'empêchant de tomber dans l'impersonnalité et l'anonymat de la masse, malheureusement trop fréquents dans la société moderne. C'est dans l'entrecroisement des relations multiples que vit la personne et que progresse la « personnalité » de la société. L'individu est souvent écrasé aujourd'hui entre les deux pôles de l'Etat et du marché. En effet, il semble parfois n'exister que comme producteur et comme consommateur de marchandises, ou comme administré de l'Etat, alors qu'on oublie que la convivialité n'a pour fin ni l'Etat ni le marché, car elle possède en elle-même une valeur unique que l'Etat et le marché doivent servir. L'homme est avant tout un être qui cherche la vérité et qui s'efforce de vivre selon cette vérité, de l'approfondir dans un dialogue constant qui implique les générations passées et à venir (102).
50. La culture de la nationest caractérisée par la recherche ouverte de la vérité qui se renouvelle à chaque génération. En effet, le patrimoine des valeurs transmises et acquises est assez souvent soumis à la contestation par les jeunes. Contester, il est vrai, ne signifie pas nécessairement détruire ou refuser a priori, mais cela vent dire surtout mettre à l'épreuve dans sa propre vie et, par une telle vérification existentielle, rendre ces valeurs plus vivantes, plus actuelles et plus personnelles, en distinguant dans la tradition ce qui est valable de ce qui est faux ou erroné, ou des formes vieillies qui peuvent être remplacées par d'autres plus appropriées à l'époque présente.
A ce propos, il convient de rappeler que l'évangélisation s'insère dans la culture des nations, en affermissant sa recherche de la vérité et en l'aidant à accomplir son travail de purification et d'approfondissement (103). Cependant, quand une culture se ferme sur elle-même et cherche à perpétuer des manières de vivre vieillies, en refusant tout échange et toute confrontation au sujet de la vérité de l'homme, elle devient stérile et va vers la décadence.
51. Toute l'activité humaine se situe à l'intérieur d'une culture et réagit par rapport à celle-ci. Pour que cette culture soit constituée comme il convient, il faut que tout l'homme soit impliqué, qu'il y développe sa créativité, son intelligence, sa connaissance du monde et des hommes. En outre, il y investit ses capacités de maîtrise de soi, de sacrifice personnel, de solidarité et de disponibilité pour promouvoir le bien commun. Pour cela, la première et la plus importante des tâches s'accomplit dans le cœur de l'homme, et la manière dont l'homme se consacre à la construction de son avenir dépend de la conception qu'il a de lui-même et de son destin. C'est à ce niveau que se situe la contribution spécifique et décisive de l'Eglise à la véritable culture. Elle favorise la qualité des comportements humains qui contribuent à former une culture de la paix, à l'encontre des modèles culturels qui absorbent l'homme dans la masse, méconnaissent le rôle de son initiative et de sa liberté et ne situent sa grandeur que dans les techniques conflictuelles et guerrières. L'Eglise rend ce service en prêchant la vérité sur la création du monde que Dieu a mise entre les mains des hommes pour la rendre féconde et la parfaire par leur travail, et en prêchant la vérité sur la rédemption par laquelle le Fils de Dieu a sauvé tous les hommes et, en même temps, les a unis les uns aux autres, les rendant responsables les uns des autres. La Sainte Ecriture nous parle constamment d'un engagement actif en faveur d'autrui et nous présente l'exigence d'une coresponsabilité qui doit impliquer tous les hommes.
Cette exigence ne s'arrête pas aux limites de la famille, ni même du peuple ou de l'Etat, mais elle concerne progressivement toute l'humanité, de telle sorte qu'aucun homme ne doit se considérer comme étranger ou indifférent au sort d'un autre membre de la famille humaine. Aucun homme ne peut affirmer qu'il n'est pas responsable du sort de son frère (cf. Gn 4, 9 ; Lc 10, 29-37 ; Mt 25, 31-46) ! Une sollicitude attentive et dévouée à l'égard du prochain au moment même où il en a besoin — facilitée aujourd'hui par les nouveaux moyens de communication sociale qui ont rendu les hommes plus proches les uns des autres — présente une importance particulière pour la recherche de modes de résolution, autres que la guerre, des conflits internationaux. Il n'est pas difficile d'affirmer que la puissance terrifiante des moyens de destruction, accessibles même aux petites et moyennes puissances, ainsi que les relations toujours plus étroites existant entre les peuples de toute la terre, rendent la limitation des conséquences d'un conflit très ardue ou pratiquement impossible.
52. Le Pape Benoît XV et ses successeurs ont clairement compris ce danger (104), et moi-même, à l'occasion de la récente et dramatique guerre du Golfe persique, j'ai repris le cri : « Jamais plus la guerre ! ». Non, jamais plus la guerre, qui détruit la vie des innocents, qui apprend à tuer et qui bouleverse également la vie de ceux qui tuent, qui laisse derrière elle une traînée de rancoeurs et de haines, rendant plus difficile la juste solution des problèmes mêmes qui l'ont provoquée! De même qu'à l'intérieur des Etats est finalement venu le temps où le système de la vengeance privée et des représailles a été remplacé par l'autorité de la loi, de même il est maintenant urgent qu'un semblable progrès soit réalisé dans la communauté internationale. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'aux racines de la guerre il y a généralement des motifs réels et graves: des injustices subies, la frustration d'aspirations légitimes, la misère et l'exploitation de foules humaines désespérées qui ne voient pas la possibilité effective d'améliorer leurs conditions de vie par des moyens pacifiques.
C'est pourquoi l'autre nom de la paix est le développement (105). Il y a une responsabilité collective pour éviter la guerre, il y a de même une responsabilité collective pour promouvoir le développement. Sur le plan intérieur, il est possible, et c'est un devoir, de construire une économie sociale qui oriente son fonctionnement dans le sens du bien commun ; des interventions appropriées sont également nécessaires pour cela sur le plan international. Il faut donc consentir un vaste effort de compréhension mutuelle, de connaissance mutuelle et de sensibilisation des consciences. C'est là la culture désirée qui fait progresser la confiance dans les capacités humaines du pauvre et donc dans ses possibilités d'améliorer ses conditions de vie par son travail, ou d'apporter une contribution positive à la prospérité économique. Mais pour y parvenir, le pauvre — individu ou nation — a besoin de se voir offrir des conditions de vie favorables concrètement accessibles. Créer de telles conditions, c'est le but d'une concertation mondiale pour le développement qui suppose même le sacrifice de positions avantageuses de revenu et de puissance dont se prévalent les économies les plus développées (106).
Cela peut comporter d'importants changements dans les styles de vie établis, afin de limiter le gaspillage des ressources naturelles et des ressources humaines, pour permettre à tous les peuples et à tous les hommes sur la terre d'en disposer dans une mesure convenable. Il faut ajouter à cela la mise en valeur de nouveaux biens matériels et spirituels, fruits du travail et de la culture des peuples aujourd'hui marginalisés, arrivant ainsi à l'enrichissement humain global de la famille des nations.
VI. L'HOMME EST LA ROUTE DE L'EGLISE
53. Face à la misère du prolétariat, Léon XIII disait : « C'est avec assurance que Nous abordons ce sujet, et dans toute la plénitude de notre droit. [...] Nous taire serait aux yeux de tous négliger notre devoir » (107). Au cours des cent dernières années, l'Eglise a manifesté sa pensée à maintes reprises, suivant de près l'évolution continue de la question sociale, et elle ne l'a certes pas fait pour retrouver des privilèges du passé ou pour imposer son point de vue. Son but unique a été d'exercer sa sollicitude et ses responsabilités à l'égard de l'homme qui lui a été confié par le Christ lui-même, cet homme qui, comme le rappelle le deuxième Concile du Vatican, est la seule créature sur terre que Dieu ait voulue pour elle-même et pour lequel Dieu a son projet, à savoir la participation au salut éternel. Il ne s'agit pas de l'homme « abstrait », mais réel, de l'homme « concret », « historique ». Il s'agit de chaque homme, parce que chacun a été inclus dans le mystère de la Rédemption, et Jésus- Christ s'est uni à chacun, pour toujours, à travers ce mystère (108). Il s'ensuit que l'Eglise ne peut abandonner l'homme et que « cet homme est la première route que l'Eglise doit parcourir en accomplissant sa mission [...], route tracée par le Christ lui-même, route qui, de façon immuable, passe par le mystère de l'Incarnation et de la Rédemption » (109).
Tel est le principe, et le principe unique, qui inspire la doctrine sociale de l'Eglise. Si celle-ci a progressivement élaboré cette doctrine d'une manière systématique, surtout à partir de la date que nous commémorons, c'est parce que toute la richesse doctrinale de l'Eglise a pour horizon l'homme dans sa réalité concrète de pécheur et de juste.
54. La doctrine sociale, aujourd'hui surtout, s'occupe de l'homme en tant qu'intégré dans le réseau complexe de relations des sociétés modernes. Les sciences humaines et la philosophie aident à bien saisir que l'homme est situé au centre de la société et à le mettre en mesure de mieux se comprendre lui- même en tant qu'«être social ». Mais seule la foi lui révèle pleinement sa véritable identité, et elle est précisément le point de départ de la doctrine sociale de l'Eglise qui, en s'appuyant sur tout ce que lui apportent les sciences et la philosophie, se propose d'assister l'homme sur le chemin du salut.
L'encyclique Rerum novarum peut être considérée comme un apport important à l'analyse socio-économique de la fin du XIXème siècle, mais sa valeur particulière lui vient de ce qu'elle est un document du magistère qui s'inscrit bien dans la mission évangélisatrice de l'Eglise en même temps que beaucoup d'autres documents de cette nature. On en déduit que la doctrine sociale a par elle-même la valeur d'un instrument d'évangélisation : en tant que telle, à tout homme elle annonce Dieu et le mystère du salut dans le Christ, et, pour la même raison, elle révèle l'homme à lui-même. Sous cet éclairage, et seulement sous cet éclairage, elle s'occupe du reste : les droits humains de chacun et en particulier du « prolétariat », la famille et l'éducation, les devoirs de l'Etat, l'organisation de la société nationale et internationale, la vie économique, la culture, la guerre et la paix, le respect de la vie depuis le moment de la conception jusqu'à la mort.
55. L'Eglise reçoit de la Révélation divine le « sens de l'homme ». « Pour connaître l'homme, l'homme vrai, l'homme intégral, il faut connaître Dieu », disait Paul VI, et aussitôt après il citait sainte Catherine de Sienne qui exprimait sous forme de prière la même idée : « Dans ta nature, Dieu éternel, je connaîtrai ma nature ».
L'anthropologie chrétienne est donc en réalité un chapitre de la théologie, et, pour la même raison, la doctrine sociale de l'Eglise, en s'occupant de l'homme, en s'intéressant à lui et à sa manière de se comporter dans le monde, « appartient [...] au domaine de la théologie et spécialement de la théologie morale » (111). La dimension théologique apparaît donc nécessaire tant pour interpréter que pour résoudre les problèmes actuels de la convivialité humaine. Cela vaut — il convient de le noter — à la fois pour la solution « athée », qui prive l'homme de l'une de ses composantes fondamentales, la composante spirituelle, et pour les solutions inspirées par la permissivité et l'esprit de consommation, solutions qui, sous divers prétextes, cherchent à le convaincre de son indépendance par rapport à Dieu et à toute loi, l'enfermant dans un égoïsme qui finit par nuire à lui-même et à autrui.
Quand elle annonce à l'hommele salut de Dieu, quand elle lui offre la vie divine et la lui communique par les sacrements, quand elle oriente sa vie par les commandements de l'amour de Dieu et du prochain, l'Eglise contribue à l'enrichissement de la dignité de l'homme. Mais, de même qu'elle ne peut jamais abandonner cette mission religieuse et transcendante en faveur de l'homme, de même, elle se rend compte que son œuvre affronte aujourd'hui des difficultés et des obstacles particuliers. Voilà pourquoi elle se consacre avec des forces et des méthodes toujours nouvelles à l'évangélisation qui assure le développement de tout l'homme. A la veille du troisième millénaire, elle reste « le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine » (112), comme elle a toujours essayé de l'être depuis le début de son existence, cheminant avec l'homme tout au long de son histoire. L'encyclique Rerum novarum en est une expression significative.
56. En ce centième anniversaire de l'encyclique, je voudrais remercier tous ceux qui ont fait l'effort d'étudier, d'approfondir et de répandre la doctrine sociale chrétienne. Pour cela, la collaboration des Eglises locales est indispensable, et je souhaite que le centenaire soit l'occasion d'un nouvel élan en faveur de l'étude, de la diffusion et de l'application de cette doctrine dans les multiples domaines.
Je voudrais en particulier qu'on la fasse connaître et qu'on l'applique dans les pays où, après l'écroulement du socialisme réel, on paraît très désorienté face à la tâche de reconstruction. De leur côté, les pays occidentaux eux-mêmes courent le risque de voir dans cet effondrement la victoire unilatérale de leur système économique et ils ne se soucient donc pas d'y apporter maintenant les corrections qu'il faudrait. Quant aux pays du Tiers-Monde, ils se trouvent plus que jamais dans la dramatique situation du sous-développement, qui s'aggrave chaque jour.
Léon XIII, après avoir formulé les principes et les orientations pour une solution de la question ouvrière, a écrit ce mot d'ordre : « Que chacun se mette sans délai à la part qui lui incombe de peur qu'en différant le remède on ne rende incurable un mal déjà si grave! ». Et il ajoutait : « Quant à l'Eglise, son action ne fera jamais défaut en aucune manière » (113).
57. Pour l'Eglise, le message social de l'Evangile ne doit pas être considéré comme une théorie mais avant tout comme un fondement et une motivation de l'action. Stimulés par ce message, quelques-uns des premiers chrétiens distribuaient leurs biens aux pauvres, montrant qu'en dépit des différences de provenance sociale, une convivialité harmonieuse et solidaire était possible. Par la force de l'Evangile, au cours des siècles, les moines ont cultivé la terre, les religieux et religieuses ont fondé des hôpitaux et des asiles pour les pauvres, les confréries ainsi que des hommes et des femmes de toutes conditions se sont engagés en faveur des nécessiteux et des marginaux, dans la conviction que les paroles du Christ « ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait » (Mt 25, 40) ne devaient pas rester un vœu pieux mais devenir un engagement concret de leur vie.
Plus que jamais, l'Eglise sait que son message social sera rendu crédible par le témoignage des œuvres plus encore que par sa cohérence et sa logique internes. C'est aussi de cette conviction que découle son option préférentielle pour les pauvres, qui n'est jamais exclusive ni discriminatoire à l'égard d'autres groupes. Il s'agit en effet d'une option qui ne vaut pas seulement pour la pauvreté matérielle : on sait bien que, surtout dans la société moderne, on trouve de nombreuses formes de pauvreté, économique mais aussi culturelle et religieuse. L'amour de l'Eglise pour les pauvres, qui est capital et qui fait partie de sa tradition constante, la pousse à se tourner vers le monde dans lequel, malgré le progrès technique et économique, la pauvreté menace de prendre des proportions gigantesques. Dans les pays occidentaux, il y a la pauvreté aux multiples formes des groupes marginaux, des personnes âgées et des malades, des victimes de la civilisation de consommation et, plus encore, celle d'une multitude de réfugiés et d'émigrés ; dans les pays en voie de développement, on voit poindre à l'horizon des crises qui seront dramatiques si l'on ne prend pas en temps voulu des mesures coordonnées au niveau international.
58. L'amour pour l'homme, et en premier lieu pour le pauvre dans lequel l'Eglise voit le Christ, se traduit concrètement par la promotion de la justice. Celle-ci ne pourra jamais être pleinement mise en œuvre si les hommes ne voient pas celui qui est dans le besoin, qui demande un soutien pour vivre, non pas comme un gêneur ou un fardeau, mais comme un appel à faire le bien, la possibilité d'une richesse plus grande. Seule cette prise de conscience donnera le courage d'affronter le risque et le changement qu'implique toute tentative authentique de se porter au secours d'un autre homme. En effet, il ne s'agit pas seulement de donner de son superflu mais d'apporter son aide pour faire entrer dans le cycle du développement économique et humain des peuples entiers qui en sont exclus ou marginalisés. Ce sera possible non seulement si l'on puise dans le superflu, produit en abondance par notre monde, mais surtout si l'on change les styles de vie, les modèles de production et de consommation, les structures de pouvoir établies qui régissent aujourd'hui les sociétés. Il ne s'agit pas non plus de détruire des instruments d'organisation sociale qui ont fait leurs preuves, mais de les orienter en fonction d'une juste conception du bien commun de la famille humaine tout entière. Aujourd'hui est en vigueur ce qu'on appelle la « mondialisation de l'économie », phénomène qui ne doit pas être réprouvé car il peut créer des occasions extraordinaires de mieux-être. Mais on sent toujours davantage la nécessité qu'à cette internationalisation croissante de l'économie corresponde l'existence de bons organismes internationaux de contrôle et d'orientation, afin de guider l'économie elle-même vers le bien commun, ce qu'aucun Etat, fût-il le plus puissant de la terre, n'est plus en mesure de faire. Pour qu'un tel résultat puisse être atteint, il faut que s'accroisse la concertation entre les grands pays et que, dans les organismes internationaux spécialisés, les intérêts de la grande famille humaine soient équitablement représentés. Il faut également qu'en évaluant les conséquences de leurs décisions, ils tiennent toujours dûment compte des peuples et des pays qui ont peu de poids sur le marché international mais qui concentrent en eux les besoins les plus vifs et les plus douloureux, et ont besoin d'un plus grand soutien pour leur développement. Il est certain qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine.
59. Afin que la justice s'accomplisse et que soient couronnées de succès les tentatives des hommes pour la mettre en œuvre, il est donc nécessaire que soit donnée la grâce qui vient de Dieu. Par la grâce, en collaboration avec la liberté des hommes, se réalise la mystérieuse présence de Dieu dans l'histoire, qui est la Providence.
La nouveauté dont on fait l'expérience à la suite du Christ doit être communiquée aux autres hommes dans la réalité concrète de leurs difficultés, de leurs luttes, de leurs problèmes et de leurs défis, afin que tout cela soit éclairé et rendu plus humain par la lumière de la foi. Celle-ci, en effet, n'aide pas seulement à trouver des solutions : elle permet aussi de supporter humainement les situations de souffrance, afin qu'en elles l'homme ne se perde pas et qu'il n'oublie pas sa dignité et sa vocation.
En outre, la doctrine sociale a une importante dimension interdisciplinaire. Pour mieux incarner l'unique vérité concernant l'homme dans des contextes sociaux, économiques et politiques différents et en continuel changement, cette doctrine entre en dialogue avec les diverses disciplines qui s'occupent de l'homme, elle en assimile les apports et elle les aide à s'orienter, dans une perspective plus vaste, vers le service de la personne, connue et aimée dans la plénitude de sa vocation.
A côté de la dimension interdisciplinaire, il faut rappeler aussi la dimension pratique et, en un sens, expérimentale de cette doctrine. Elle se situe à la rencontre de la vie et de la conscience chrétienne avec les situations du monde, et elle se manifeste dans les efforts accomplis par les individus, les familles, les agents culturels et sociaux, les politiciens et les hommes d'Etat pour lui donner sa forme et son application dans l'histoire.
60. En énonçant les principes de solution de la question ouvrière, Léon XIII écrivait : « Une question de cette importance demande encore à d'autres agents leur part d'activité et d'efforts » (114). Il était convaincu que les graves problèmes causés par la société industrielle ne pouvaient être résolus que par la collaboration entre toutes les forces. Cette affirmation est devenue un élément permanent de la doctrine sociale de l'Eglise, et cela explique notamment pourquoi Jean XXIII a adressé aussi à « tous les hommes de bonne volonté » son encyclique sur la paix.
Toutefois, le Pape Léon XIII constatait avec tristesse que les idéologies de son temps, particulièrement le libéralisme et le marxisme, refusaient cette collaboration. Depuis lors, bien des choses ont changé, surtout ces dernières années. Le monde prend toujours mieux conscience aujourd'hui de ce que la solution des graves problèmes nationaux et internationaux n'est pas seulement une question de production économique ou bien d'organisation juridique ou sociale, mais qu'elle requiert des valeurs précises d'ordre éthique et religieux, ainsi qu'un changement de mentalité, de comportement et de structures. L'Eglise se sent en particulier le devoir d'y apporter sa contribution et, comme je l'ai écrit dans l'encyclique Sollicitudo rei socialis, il y a un espoir fondé que même les nombreuses personnes qui ne professent pas une religion puissent contribuer à donner à la question sociale le fondement éthique qui s'impose (115).
Dans le même document, j'ai aussi lancé un appel aux Eglises chrétiennes et à toutes les grandes religions du monde, les invitant à donner un témoignage unanime des convictions communes sur la dignité de l'homme, créé par Dieu (116). Je suis convaincu, en effet, que les religions auront aujourd'hui et demain un rôle prépondérant dans la conservation de la paix et dans la construction d'une société digne de l'homme.
D'autre part, il est demandé à tous les hommes de bonne volonté d'être disposés au dialogue et à la collaboration, et cela vaut en particulier pour les personnes et les groupes qui ont une responsabilité propre dans les domaines politique, économique et social, que ce soit au niveau national ou international.
61. Au début de la société industrielle, c'est l'existence d'un « joug quasi servile » qui obligea mon prédécesseur à prendre la parole pour défendre l'homme. L'Eglise est restée fidèle à ce devoir au cours des cent ans qui se sont écoulés depuis. En effet, elle est intervenue à l'époque tumultueuse de la lutte des classes, après la première guerre mondiale, pour défendre l'homme contre l'exploitation économique et la tyrannie des systèmes totalitaires. Après la seconde guerre mondiale, elle a centré ses messages sociaux sur la dignité de la personne, insistant sur la destination universelle des biens matériels, sur un ordre social exempt d'oppression et fondé sur l'esprit de collaboration et de solidarité. Elle a sans cesse répété que la personne et la société ont besoin non seulement de ces biens mais aussi des valeurs spirituelles et religieuses. En outre, comme elle se rendait toujours mieux compte que trop d'hommes, loin de vivre dans le bien- être du monde occidental, subissent la misère des pays en voie de développement et sont dans une situation qui est encore celle du « joug quasi servile », elle s'est sentie et elle se sent obligée de dénoncer cette réalité en toute clarté et en toute franchise, bien qu'elle sache que ses appels ne seront pas toujours accueillis favorablement par tous.
Cent années après la publication de Rerum novarum, l'Eglise se trouve encore face à des « choses nouvelles » et à des défis nouveaux. C'est pourquoi ce centenaire doit confirmer dans leur effort tous les hommes de bonne volonté et en particulier les croyants.
62. La présente encyclique a voulu regarder le passé mais surtout se tourner vers l'avenir. Comme Rerum novarum, elle se situe presque au seuil du nouveau siècle et elle entend, avec l'aide de Dieu, préparer sa venue.
La véritable et permanente « nouveauté des choses » vient en tout temps de la puissance infinie de Dieu, qui dit : « Voici, je fais toutes choses nouvelles » (Ap 21, 5). Ces paroles se réfèrent à l'accomplissement de l'histoire, quand le Christ « remettra la royauté à Dieu le Père... afin que Dieu soit tout en tous » (1 Co 15, 24.28). Mais le chrétien sait bien que la nouveauté que nous attendons dans sa plénitude au retour du Seigneur est présente depuis la création du monde, et plus exactement depuis que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, et qu'avec lui et par lui il a fait une « création nouvelle » (2 Co 5, 17 ; cf. Ga 6, 15).
Avant de conclure, je rends grâce encore une fois à Dieu tout-puissant qui a donné à son Eglise la lumière et la force nécessaires pour accompagner l'homme dans son cheminement terrestre vers son destin éternel. Au troisième millénaire aussi, l'Eglise continuera fidèlement à faire sienne la route de l'homme, sachant qu'elle ne marche pas toute seule mais avec le Christ, son Seigneur. C'est lui qui a fait sienne la route de l'homme et qui le conduit, même s'il ne s'en rend pas compte.
Puisse Marie, Mère du Rédempteur, elle qui reste auprès du Christ dans sa marche vers les hommes et avec les hommes, et qui précède l'Eglise dans son pèlerinage de la foi, accompagner de sa maternelle intercession l'humanité vers le prochain millénaire, dans la fidélité à Celui qui « est le même hier et aujourd'hui » et qui « le sera à jamais » (cf. He 13, 8), Jésus-Christ, notre Seigneur, au nom duquel, de grand cœur, j'accorde à tous ma Bénédiction.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 1er mai 1991 — mémoire de saint Joseph, travailleur —, en la treizième année de mon pontificat.
1 Leone XIII, lett. enc. Rerum novarum (15 maggio 1891): Leonis XIII P.M. Acta, XI, Romae 1892, 97-144.
5 Cf S. Ireneo, Adversus haereses, I, 10, 1; III, 4, 1: PG 7, 549 s.; 855 s.; S Ch. 264, 154 s.; 211, 44-46.
7 Cf, ad es., Leone XIII, epist. enc. Arcanum, divinae sapientiae (10 febbraio 1880): Leonis XIII P.M. Acta, II, Romae 1882, 10-40; epist. enc. Diuturnum illud (29 giugno 1881): Leonis XIII P.M. Acta, II, Romae 1882, 269-287; lett. enc. Libertas praestantissimum (20 giugno 1888): Leonis XIII P.M. Acta, VIII, Romae 1889, 212-246; epist. enc. Graves de communi (18 gennaio 1901): Leonis XIII P.M. Acta, XXI, Romae 1902, 3-20.
10 Cf ibid.: l.c., 109 s.
11Cf ibid.: descrizione delle condizioni di lavoro; associazioni operaie anti-cristiane: l.c., 110 s.; 136 s.
12 Ibid.: l.c., 130; cf anche 114 s.
17 Cf ibid.: l.c., 102 s.
18 Cf ibid.: l.c., 101-104.
19 Cf ibid.: I.c., 134 s.; 137 s.
21 Cf ibid.: l.c., 128-129.
26Cf Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
30Cf Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; Dichiarazione sull’eliminazione di ogni forma di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o sulle convinzioni.
38Conc. Ecum. Vat. II, cost. past. sulla chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes, 24.
47Cf epist. enc. Arcanum divinae sapientiae (10 febbraio 1880): Leonis XIII P.M. Acta, II, Romae 1882, 10-40; epist. enc. Diuturnum illud (29 giugno 1881): Leonis XIII P.M. acta, II, Romae 1882, 269-287; epist. enc. Immortale Dei(1° novembre 1885): Leonis XIII P.M. Acta, V, Romae 1886, 118-150; lett. enc. Sapientiae Christiane (10 gennaio 1890): Leonis XIII P.M. Acta, X, Romae 1891, 10-41; epist. enc. Quod apostolici muneris (28 dicembre 1878): Leonis XIII P.M. Acta, I, Romae 1881, 170-183; lett. enc, Libertas praestantissimum (20 giugno 1888): Leonis XIII P.M. Acta, VIII, Romae 1889, 212-246.
51Cf Giovanni XXIII, lett. enc. Pacem in terris (11 aprile 1963), III: AAS 55 (1963), 286-289.
52Cf Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, del 1948; Giovanni XXIII, lett. enc. Pacem in terris, IV: l.c., 291-296; «Atto Finale» della Conferenza sulla sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), Helsinki 1975.
55Cf Conc. Ecum. Vat. II, costituzione pastorale sulla chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes, 36; 39.
58Cf Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione sulla libertà cristiana e la liberazione Libertatis conscientia (22 marzo 1986): AAS 79 (1987), 554-599.
66Ibid.: l.c., 111-113 s.
74Cf ibid., l.c., 594-598.
79 Cf ibid, 34: l.c., 599 s.
81 Cf Conc. Ecum. Vat. II, cost. past. sulla chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes, 24.
84 Cf Conc. Ecum. Vat. II, cost. past. sulla chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes, 36; Paolo VI, lett. ap. Octogesima adveniens, 2-5: l.c., 402-405.
86 Cf ibid., 10: l. c., 600-602.
87 Cf ibid., 14: l. c., 612-616.
88 Cf ibid., 18: l. c., 622-625.
90 Cf ibid., l. c., 121 s.
92Cf Conc. Ecum. Vat. II, cost. past. sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes, 76.
98Conc. Ecum. Vat. II, cost. past. sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes, 26.
104Cf Benedetto XV, esort. Ubi primum(8 settembre 1914): AAS 6 (1914), 501 s.; Pio XI, Radiomessaggio a tutti i fedeli cattolici e a tutto il mondo (29 settembre 1938): AAS 30 (1938), 309 s.; Pio XII, Radiomessaggio a tutto il mondo (24 agosto 1939), 333-335; Giovanni XXIII, lett. enc. Pacem in terris, III: l. c., 285-289; Paolo VI, Discorso all’ONU (4 ottobre 1965): AAS 57 (1965), 877-885.
109Ibid., 14: l. c., 284 s.
116Ibid., 47: l. c., 582.
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana









.jpg)